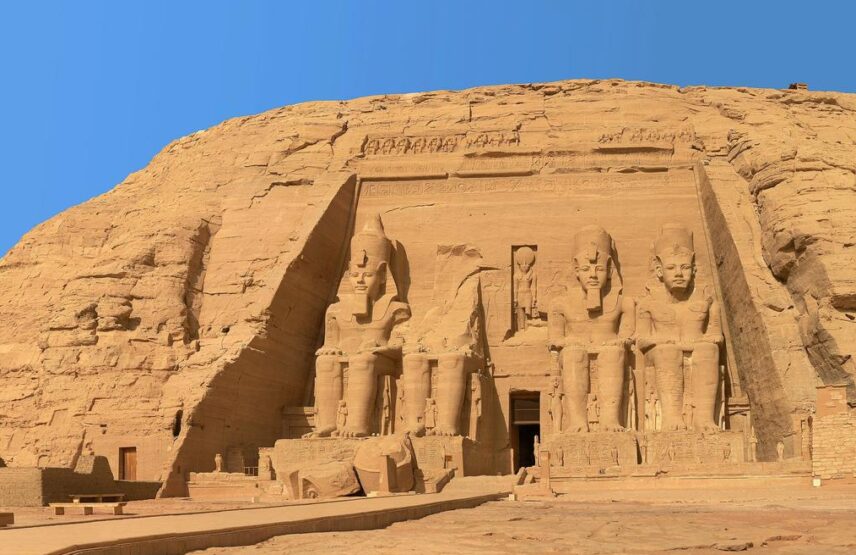Archéologie des guerres napoléoniennes (7/7). Pour une intégration à l’archéologie des conflits

La médaille de Sainte‐Hélène (détail) découverte sur le squelette exhumé à Cons-la-Granville en 2021. © J.‐D. Laffite, Inrap
L’essor de l’archéologie préventive a favorisé le développement d’une archéologie des conflits modernes et contemporains. Des premières campagnes du jeune général Bonaparte à celles menées sous l’Empire, les guerres napoléoniennes ont bénéficié, dans le contexte des bicentenaires, de fouilles d’envergure – tant en France qu’à l’étranger, avec de nouveaux enjeux scientifiques. Ces découvertes inédites viennent enrichir un corpus d’une cinquantaine de sites enfin constitué ; ce dossier d’Archéologia vous en dévoile toute la richesse.
L’auteur de ce dossier est : Frédéric Lemaire, docteur en histoire et en archéologie, archéologue à l’Inrap, spécialisé dans l’étude des grands conflits contemporains, directeur des recherches sur le camp de Boulogne, les champs de bataille de Russie et l’île-prison de Cabrera aux Baléares

Portrait de Charles Étienne Gudin de la Sablonnière (1768-1812 ). Gravure d’Ambroise Tardieu, 1818. Collection Stella. © Stefano Bianchetti, Bridgeman Images
L’étude des sites liés aux guerres napoléoniennes, initiée dans ce dossier, met en lumière un pan important de l’histoire militaire européenne. La carte des occurrences archéologiques, inédite à ce jour, montre une répartition géographique étendue et une diversité de découvertes couvrant l’ensemble des campagnes, depuis les camps d’entraînement en France jusqu’aux champs de bataille emblématiques de Russie, en passant par l’île-prison des Baléares, ou encore les traces laissées par les vétérans. Toutes nous permettent d’approcher les réalités humaines, sociales et matérielles de ces événements.
Une grande oubliée ?
Cependant, une question demeure : pourquoi cette archéologie est-elle si peu intégrée aux cadres institutionnels et aux synthèses nationales, comme l’illustre l’absence des découvertes dans le récent Atlas archéologique de la France publié en 2024 ? Absence qui contraste fortement avec l’attention portée aux deux grands conflits du XXe siècle. La réflexion engagée par Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp sur la réception de certains pans de l’histoire trouve ici un écho pertinent : ce passé, à la fois glorieux et douloureux, suscite-t-il encore des résistances ?

La médaille de Sainte‐Hélène découverte sur le squelette exhumé à Cons-la-Granville en 2021. Elle a rendu possible l’identification du soldat de la Garde impériale Jean-Jacques Zentz, décédé en 1876. La médaille de Sainte‐Hélène fut créée en 1857 par Napoléon III pour les vétérans des campagnes de 1792 à 1815. © J.‐D. Laffite, Inrap
De nouvelles perspectives
Au-delà de cette problématique, cette recherche ouvre des perspectives importantes pour l’archéologie de la guerre. En montrant que l’héritage napoléonien peut être étudié avec les mêmes outils et méthodes que les belligérances plus récentes, elle invite à dépasser les clivages chronologiques et disciplinaires pour intégrer pleinement cette période dans une approche globale du conflit. À travers les quelque 50 sites identifiés à ce jour, l’histoire des guerres napoléoniennes se révèle dans toute sa matérialité, offrant un regard renouvelé sur cette période qui a profondément marqué l’Europe mais également le monde entier, comme l’a justement rappelé l’historien A. Mikaberidze dans son livre paru en 2020, The Napoleonic Wars. A Global History. Cela impose aux chercheurs, mais aussi aux institutions, de repenser la place de ces vestiges dans notre mémoire collective et dans les narrations archéologiques contemporaines. C’est en interrogeant nos réticences et nos silences que nous pourrons redonner toute sa place à cette archéologie, entre histoire et mémoire.
Pour aller plus loin :
BLESSING J.-M. (dir.), 2017, Clashes of Time: The Contemporary Past as a Challenge for Archaeology, Louvain, Presses universitaires de Louvain.
BRUN J.-F., 2023, La Grande Armée – Analyse d’une machine de guerre, Villers-sur-Mer, Éditions Pierre de Taillac.
DEMOULE J.-P. et SCHNAPP A., 2024, Qui a peur de l’archéologie ? La France face à son passé, Paris, Les Belles Lettres.
HOUDECEK F., 2023, Vivre la Grande Armée. Être soldat au temps de Napoléon, Paris, CNRS éditions.
JOURNOT F. et BELLAN G., 2011, Archéologie de la France moderne et contemporaine, Paris, Éditions La Découverte.
SEMELIN J. et GUILAINE J., 2016, Violences de guerre, violences de masse : une approche archéologique, Paris, Éditions La Découverte.
Sommaire
Archéologie des guerres napoléoniennes