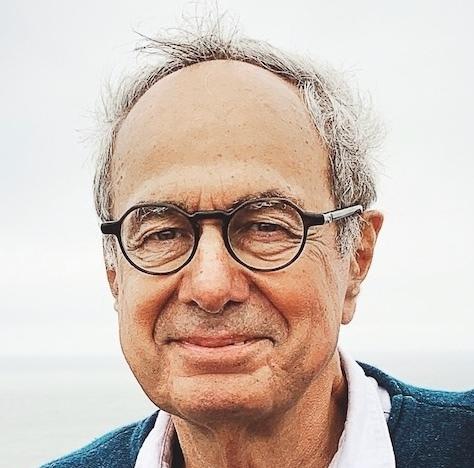Grandes questions de l’archéologie : « Le complexe de Pausanias »

Charles Giraud (1819-1892), Musée Napoléon III, galerie des céramiques au musée du Louvre, Salon de 1866. Féru d’archéologie nationale, l’empereur acquiert la collection d’antiques du marquis Campana, collection composée essentiellement d’antiques méditerranéens… Inaugurée en 1864, cette présentation au Louvre est un événement. Huile sur toile. Paris, musée du Louvre. © Grand-Palais RMN (musée du Louvre), Jacques L'Hoir, Jean Popovitch
Le complexe de Pausanias est le nom qu’a donné mon collègue Alain Schnapp au syndrome français qui, en matière d’archéologie et du moins chez certains décideurs politiques et économiques, fait toujours préférer l’archéologie ailleurs plutôt qu’en France même – un syndrome que l’on peut faire remonter au Moyen Âge mais qui est resté bien vivace jusqu’à ces temps-ci, comme l’ont encore montré l’an dernier les déclarations de la ministre Rachida Dati et du député Éric Ciotti (Archéologia, no 631, mai 2024, p. 9 et no 632, p. 8-9).
Au IIe siècle de notre ère, dans le neuvième livre de sa Description de la Grèce, le géographe et historien grec Pausanias écrivait en effet ceci : « Les Grecs montrent plus de talent à admirer ce qui provient de l’étranger que ce qui se trouve chez eux, en sorte que si les meilleurs de leurs érudits ont analysé dans le moindre détail les pyramides des Égyptiens, ils n’ont pas accordé le moindre souvenir au trésor de Minyas ou aux murs de Tirynthe qui ne sont en rien moins admirables. »
Le Louvre au cœur de l’actualité
Ne venons-nous pas d’en avoir un nouvel exemple ? On ne saurait douter que notre grand musée du Louvre, avec ses dix millions de visiteurs, est l’un des mieux dotés et des plus célèbres au monde. À tel point que ses directeurs successifs, bien que leur musée dépende en principe du seul ministère de la Culture, font fort rarement passer leurs demandes par leur tutelle mais traitent directement avec le président de la République du moment. C’est exactement ce que vient de faire la directrice (il y a, pour la première fois, une directrice à la tête du Louvre) en réclamant, face à trop d’affluence, encore plus de crédits et d’aménagements nouveaux. Elle a immédiatement reçu l’oreille du président de la République, qui a soutenu publiquement ses demandes. Plusieurs médias, pourtant usuellement bien disposés à l’égard du musée du Louvre, émirent un certain scepticisme face aux urgences invoquées.

Vue extérieure du musée du Louvre. © DR
Et le musée d’Archéologie nationale ?
Mais aucun, sauf erreur, ne fit la comparaison avec le musée d’Archéologie nationale, pourtant bien plus dépourvu en crédits et en soutiens que le Louvre. Le fait est d’autant plus paradoxal que le thème de l’identité nationale, de la mémoire et des racines est partagé par plusieurs partis politiques, et notamment ceux des personnalités citées plus haut ; que certains ne cessent de déplorer, contre toute évidence, que le récit (ou le roman) national serait insuffisamment enseigné dans les établissements scolaires ; et que pullulent un peu partout, réalisés ou en projet, spectacles ou parcs à thèmes voués à l’histoire nationale sous l’angle des « grands hommes ».
Un musée mal aimé…
Il est vrai que l’histoire de notre musée d’Archéologie nationale (jusqu’en 2005 « des Antiquités nationales ») a toujours été difficile. Créé à la Révolution par Alexandre Lenoir, il fut aussitôt dissout à la Restauration. En 1843, le député et astronome François Arago haranguait ainsi le parlement : « Nous trouvons, Messieurs, dans l’ensemble des établissements de Paris, des collections grecques, romaines, égyptiennes ; les sauvages d’Océanie eux-mêmes n’ont pas été oubliés ; il est temps de penser quelque peu à nos ancêtres ; faisons que la capitale de la France renferme aussi un musée historique français. » Il faut pourtant attendre Napoléon III, intéressé par l’histoire et soucieux aussi d’asseoir son pouvoir autoritaire sur un sentiment d’identité nationale. Il avait déjà lancé en 1858 la Commission de topographie des Gaules, chargée de recenser les sites archéologiques et d’entreprendre des fouilles, y compris à Alésia. Il institua donc en 1862 un Musée gallo-romain, qu’il inaugura en 1867. Mais, significativement, il l’installa, non au cœur de la capitale, mais dans une lointaine banlieue résidentielle en faisant lourdement restaurer un ancien château royal, devenu entre-temps caserne puis prison militaire, et qu’il transforma en faux château Renaissance.

Vue extérieure du château de Saint-Germain-en-Laye abritant le musée d'Archéologie nationale. © MAN
… et abandonné par les pouvoirs publiques successifs
Si dans un premier temps, avec son directeur Alexandre Bertrand, assisté du préhistorien Gabriel de Mortillet, ce musée joua un rôle essentiel pour centraliser les nombreuses découvertes des membres bénévoles des diverses sociétés savantes, accumulant archives et publications, il fut peu à peu abandonné par les pouvoirs politiques successifs. Le hiatus entre une archéologie française à l’étranger, appuyée sur des institutions prestigieuses et des professionnels, et une archéologie métropolitaine reposant pour l’essentiel sur des notables locaux passionnés mais bénévoles et sans moyens, se poursuivra au moins jusque dans les années 1970. Le paradoxe est qu’en même temps les gouvernements français imposaient dans les colonies d’Afrique du Nord une législation qui instituait la propriété publique des découvertes archéologiques, alors qu’il faudra attendre… 2016 pour qu’une telle mesure concerne enfin le sous-sol métropolitain. Encore que, la loi n’étant pas rétroactive, elle ne s’appliquera que pour les nouveaux propriétaires qui auront acquis des terrains par héritage ou achat. Jusqu’en 1941, chacun resta donc libre de creuser le sol à sa guise, la loi (validée en 1945, mais déjà en germe sous le Front populaire) ne s’étant alors facilement imposée que par l’absence de tout parlement et de toute opposition.
Un syndrome persistant ?
Il faudra également attendre 1992 pour que la France signe la convention de Malte, obligeant la cinquantaine de pays membres du Conseil de l’Europe à mettre en place des législations sur l’archéologie préventive, du moins pour les rares (dont la France) qui ne l’avaient pas encore fait – puis dix ans de plus pour que soit enfin votée la loi de 2001 instituant le paiement par les aménageurs des fouilles préventives nécessaires, et créant l’Institut national de recherches archéologiques préventive, l’Inrap. Mais là encore, le syndrome de Pausanias frappa immédiatement et la loi à peine votée faillit être remise totalement en cause, jusqu’à ce qu’on aboutisse à l’actuel compromis. Même si, grâce en partie aux actions pédagogiques de l’Inrap qui ont rencontré un indéniable soutien du public, visiblement moins sujet à ce syndrome, ces oppositions s’affaiblissent avec le temps.

Vue aérienne du chantier de fouille préventive réalisée par l'Inrap en amont de l'extension du Parc industriel de la plaine de l'Ain sur les communes de Saint-Vulbas et de Blyes (Ain). © Inrap
Partout sauf chez moi
Il n’est cependant pas exceptionnel que certains élus ou aménageurs témoignent encore d’un syndrome proche, appelé NIMBY en franglais : Not In My BackYard – c’est-à-dire, Pas dans mon arrière-cour, ou autrement dit, partout sauf chez moi. Ils aiment l’archéologie, mais en Égypte ou au Mexique. Et quel responsable d’opération archéologique n’a pas entendu, de la part d’un aménageur scrutant d’un air sceptique la fouille en cours qu’il finance : « mais ce n’est quand même pas la tombe de Néfertiti » – ou « de Toutankhamon » ou « Pompéi ». Positivons : ces réactions tendent à se raréfier. Raison de plus pour rester vigilant.
Pour aller plus loin :
CORNU M., FROMAGEAU J. & POULOT D. (dir.), 2022, 2002. Genèse d’une loi sur les musées, Paris, La Documentation française.
DEMOULE J.-P. & LANDES Chr. (dir.), 2009, La fabrique de l’archéologie, Paris, La Découverte et Inrap.
DEMOULE J.-P. & SCHNAPP A., 2024, Qui a peur de l’archéologie ? La France face à son passé, Paris, Les Belles Lettres.
GARCIA D. (dir.), 2021, La fabrique de la France. 20 ans d’archéologie préventive, Paris, Flammarion & Inrap.
LOUBOUTIN C. & LEHOËRFF A. (dir.), 2024, Archéologie en musée et identités nationales en Europe (1848-1914). Un héritage en quête de nouveaux défis au 21e siècle, Leyde, Sidestone Press.
NEGRI V. & SCHLANGER N. (dir.), 2024, 1941 : Genèse et développements d’une loi sur l’archéologie, Paris, La documentation française.
THIESSE A.-M., 1999, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris, Le Seuil.