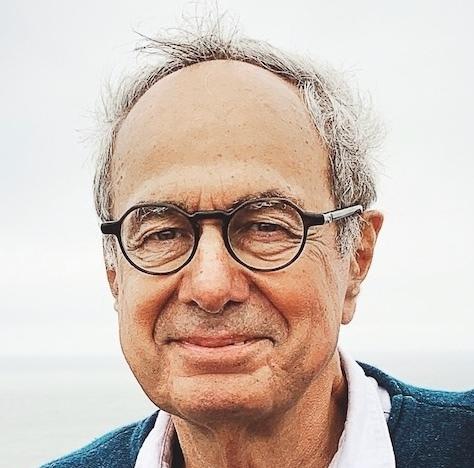Grandes questions de l’archéologie : « Le Néolithique est à la mode ! »

Le site de Karahan Tepe en 2023. By Vincent Vega - Own work, CC BY-SA 4.0
Il est de bon ton, ces temps-ci, de critiquer le Néolithique. Pour l’historien israélien Yuval Harari dans son best-seller Sapiens, l’invention de l’agriculture aurait été la pire décision de l’espèce humaine. En dix millénaires à peine, soit 5 % seulement de la durée d’existence totale de l’espèce Homo sapiens, n’est-on pas passé, de deux ou trois millions d’humains sur la totalité de la planète, aux huit et bientôt dix milliards actuels, dans une fuite en avant sans contrôle ?
Et de petites communautés nomades de quelques dizaines d’individus à nos mégalopoles ingérables de plusieurs dizaines de millions d’habitants ? Et finalement de sociétés faiblement inégalitaires à notre monde d’aujourd’hui où la vingtaine d’hommes (mâles) les plus riches du monde possède autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité ? Comme si c’était les techniques en elles-mêmes qui étaient la cause de ces problèmes, et non pas l’usage qu’en font les sociétés.
Le premier World Neolithic Congress
Et pourtant les études néolithiques se portent fort bien. Son enseignement, quasiment inexistant en France il y a cinquante ans, est maintenant dispensé en détail dans une douzaine d’universités. Plus actuel encore, s’est tenu pendant une semaine en novembre 2024 à Sanliurfa en Turquie le premier World Neolithic Congress. Il a réuni un millier de participants provenant de 63 pays et issus de 486 institutions scientifiques. Ce nombre de participants impliquait que, comme dans toutes les grandes réunions internationales comparables, plusieurs sessions thématiques fonctionnent en parallèle. Le choix de Sanliurfa, ville proche de la frontière syrienne, ne devait rien au hasard. Elle se trouve à quelques kilomètres du célèbre site archéologique de Göbekli Tepe qui, fouillé à partir des années 1990, a bouleversé notre vision du Néolithique. En effet, au lieu de constructions en terre et en bois et de quelques modestes figurines en terre cuite ou en pierre, le site arbore, dès le IXe millénaire avant notre ère, au moins une vingtaine de constructions circulaires d’environ 20 m de diamètre. Dans leurs murs en pierres sèches sont incluses perpendiculairement des dalles en calcaire de 3 m de hauteur sur lesquelles sont figurés en bas-reliefs divers animaux sauvages, mâles en général. Au centre de chaque construction, deux dalles, hautes cette fois de 5 m et de forme humaine schématique, se font face.
« Premiers temples de l’humanité »
Ces constructions n’étaient pas des lieux de vie et ont été régulièrement qualifiées de « premiers temples de l’humanité » – même si les grottes peintes du Paléolithique furent aussi à l’évidence des lieux de communication avec un surnaturel supposé. En outre, des sculptures d’animaux en ronde-bosse, et parfois d’humains, jalonnent le site. Site qui n’est pas isolé puisque des prospections intensives en ont mis d’autres en évidence dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, parfois plus modestes, mais parfois tout aussi spectaculaires, comme celui en cours de fouilles à Karahan Tepe. La municipalité d’Urfa vient donc d’ouvrir un impressionnant musée qui, s’il couvre les périodes préhistoriques et historiques de la région, est principalement concentré sur ces sites néolithiques. Même si la pierre utilisée est le calcaire, matériau plus facile à travailler que le granite, constructions et sculptures représentent à l’évidence de remarquables exploits techniques pour l’époque. On ignore si toutes les constructions de Göbekli Tepe ont été contemporaines ou successives, mais elles furent toutes volontairement condamnées et comblées de terre – donc ni détruites, ni laissées à l’abandon. Aussi l’interprétation historique de l’ensemble de ces phénomènes fait-elle l’objet de nombreux débats, ces sociétés ne reposant jusque-là que sur la chasse et la cueillette. Néanmoins, à l’échelle du Proche-Orient, des vestiges comparables sont connus, comme la massive tour de pierre fouillée à Jéricho dans les années 1950.

Vue du musée archéologique de Sanliurfa en Turquie. © DR
Débats en cours
L’image du Néolithique devient ainsi infiniment plus complexe. Le schéma linéaire qui s’est longtemps imposé a régulièrement été remis en cause, et encore dans le best-seller de David Graeber et David Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, même si on a pu leur objecter d’une part que d’autres auteurs avaient plaidé avant eux pour des développements historiques plus complexes, et d’autre part qu’une partie de leurs exemples archéologiques était discutable. Dans la mouvance de l’« anthropologie anarchiste » (Archéologia, no 589, p. 8-9), James C. Scott, récemment disparu, a relativisé les avantages immédiats qu’aurait apportés l’agriculture sédentaire. Symétriquement, l’anthropologue Charles Stépanoff a critiqué ces approches et proposé une vision nouvelle de la domestication, notamment animale. Plutôt qu’une domination brutale et délibérée sur la nature et les animaux, il a insisté, avec la notion d’« attachement », sur le propre des primates humains, par rapport à leurs cousins, à manifester de l’empathie pour les autres êtres vivants. Cette empathie est plus marquée encore chez les femmes que chez les hommes, et celles-ci adoptent et allaitent même volontiers des animaux nouveau-nés sauvages capturés par leurs époux. Admis pour la domestication des chiens à partir des loups dès le Paléolithique supérieur, ces processus empathiques pourraient être généralisés à d’autres espèces.
Outre ses premières atteintes à l’environnement, est aussi reprochée au Néolithique l’émergence du patriarcat, qui aurait mis fin à un matriarcat idyllique des temps paléolithiques, une thèse récurrente mais que peu d’arguments étayent.
Rencontres et colloques
Longtemps parent pauvre de la recherche archéologique dans notre pays, le Néolithique réunit désormais tous les deux ans les chercheurs de la moitié nord de la France lors des colloques Internéo, qui alternent avec une simple journée d’étude, tandis que ceux de la moitié sud se rassemblent avec la même périodicité lors des Rencontres méridionales de préhistoire récente. De fait, les grandes fouilles préventives ont été beaucoup plus nombreuses dans le Nord de la France que dans le Sud et, à côté des centaines de maisons du Néolithique le plus ancien du Bassin parisien, on ne compte que quelques unités sur les rives méditerranéennes, même si un nouveau plan vient d’être exhumé sur le site de Cavalaire.
L’ensemble de la profession se regroupe de manière fédérative dans les Rencontres Nord-Sud de préhistoire récente, auxquelles s’adjoint l’Association pour la promotion des recherches sur l’Âge du bronze (APRAB). On notera aussi le flottement terminologique qui fait qualifier le Néolithique de « protohistoire » dans le Nord de la France, mais de « préhistoire récente » dans le Sud, cette dernière incluant même l’Âge du bronze. Sans compter le terme de « chalcolithique », tout aussi fluctuant suivant les régions. On signalera enfin, au niveau international, les colloques Emergence of the Neolithic of Europe (ENE), dont le premier a eu lieu à Barcelone, et le second doit se tenir en mai 2025 à Zadar en Croatie. Quant au World Neolithic Congress, le second devrait se tenir en 2028 en Chine.

Vue générale du chantier de fouille de l’un des plus anciens habitats néolithiques de France à Cavalaire-sur-Mer dans le Var. © Inrap, Sylvain Barbier
Pour aller plus loin :
DEMOULE J.-P., 2019, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire. Quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs, Paris, Fayard.
DEMOULE J.-P. (dir.), 2023, La révolution néolithique dans le monde, Paris, CNRS Éditions.
HADAD R., 2024, « Re-Territorializing the Neolithic: Architecture and Rhythms in Early Sedentary Societies of the Near East », Comparative Studies in Society and History, 66 (3), p. 1-27.
SCHMIDT K., 2015, Le premier temple : Göbekli Tepe, Paris, CNRS Éditions.
SCOTT J. C., 2019, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, Paris, La Découverte.
STÉPANOFF Ch., 2024, Attachements : Enquête sur nos liens au-delà de l’humain, Paris, La Découverte.
VIGNE J.-D., 2024, La domestication à l’œil nu, Paris, CNRS Éditions.