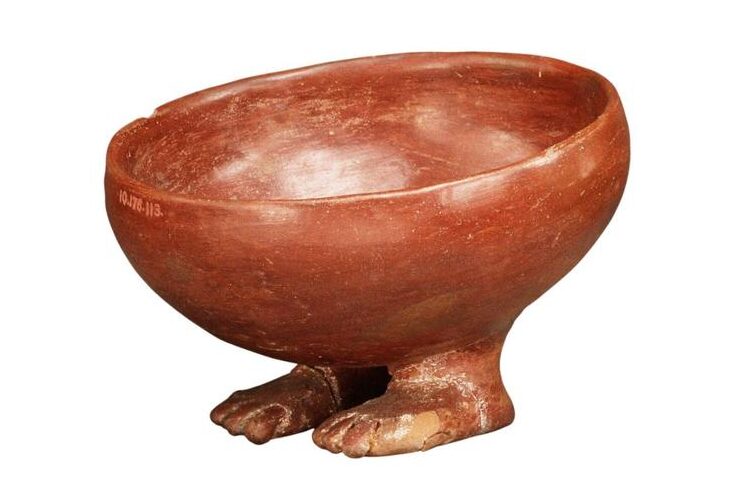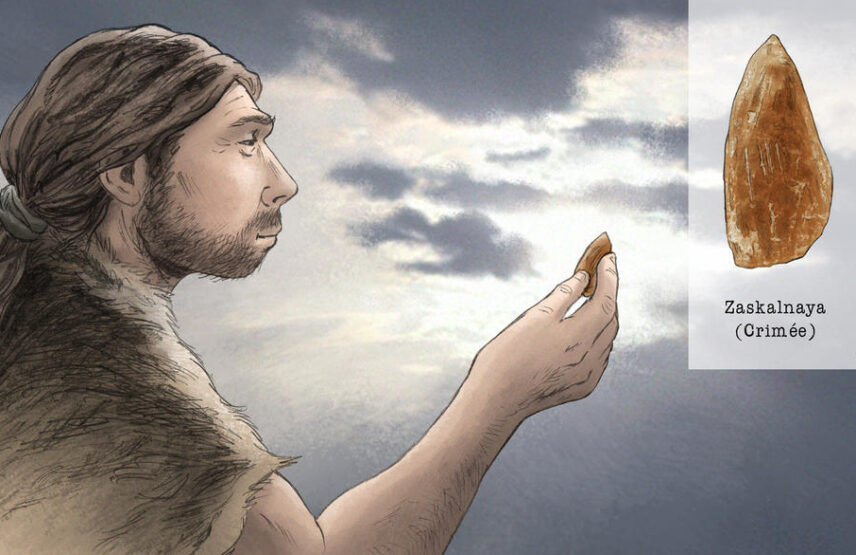Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire (5/7). Les derniers mammouths

Découverte d’un bébé mammouth complet, surnommé Dima, dans le pergélisol en 1977 en Sibérie orientale. Elle est âgée d’environ 40 000 ans ; quelques poils et son ADN, en partie conservés, sont riches d’informations sur l’animal, son régime alimentaire et son environnement. © Sovfoto / UIG / Bridgeman Images
Dès la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle leur existence est connue, les mammouths (du russe mamont) ont passionné les premiers chercheurs. Une fascination qui ne s’est jamais démentie auprès du grand public : la taille de ces pachydermes, la forme de leurs défenses, la longueur de leur trompe et leur abondante fourrure concourent toujours à en faire aujourd’hui les stars des animaux préhistoriques. À l’occasion, fin février 2023, du retour du célèbre mammouth de Durfort au Muséum national d’Histoire naturelle après un an de restauration, Archéologia vous propose un dossier « Mammouth » pour mieux connaître ces pachydermes de la Préhistoire et leurs contemporains tout en faisant la synthèse des derniers apports de la paléontologie.
Les auteurs du dossier sont : Amélie Vialet (auteur et coordinatrice), Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP ; Philippe Fosse et Jean-Philip Brugal, UMR 7269, LAMPEA, université Aix-Marseille ; George Konidaris, université de Tübingen (Allemagne) ; Dimitris Kostopoulos, université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Ran Barkai, université de Tel-Aviv (Israël) ; Frédéric Plassard, responsable de la grotte de Rouffignac, UMR 5199, PACEA, université de Bordeaux ; Régis Debruyne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209, AASPE ; Anne-Marie Moigne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP.
Ce dossier a été conçu en hommage à deux grands paléontologues qui nous ont quittés récemment : Emiliano Aguirre (1925-2021) et Yves Coppens (1934-2022).

Évocation d’une famille de mammouths (Mammuthus primigenius) dans la steppe eurasienne il y a 30 000 ans. © akg-images / Paul Becx, The Netherlands Science Photo Library
La lignée des mammouths a connu une expansion spectaculaire au cours du Pléistocène, colonisant tout le continent eurasiatique et s’étendant même jusqu’au Mexique à la faveur des régressions marines successives. Pourtant, à la suite du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, leur aire de distribution s’est très rapidement contractée, et leurs effectifs se sont effondrés, jusqu’à leur complète disparition il y a quelques milliers d’années, n’en déplaisent aux actuelles tentatives de « désextinction ».
Les mammouths ne sont pas les seules victimes de l’époque : de nombreuses espèces de la « mégafaune glaciaire » s’éteignent également à la toute fin du Pléistocène. Plusieurs hypothèses, non exclusives, ont été avancées pour expliquer ces disparitions, et elles ont quasiment toutes été reprises pour le mammouth laineux, principal héraut de cette faune passée. Parmi elles, l’hypothèse d’une « blitzkrieg », causée par la chasse associée au développement démographique humain, fait l’objet d’un débat continuel depuis 50 ans : les modélisations des effets de la chasse sur les différents continents produisent des résultats difficiles à concilier, voire clairement contradictoires à ce sujet. Autre hypothèse : celle de l’hyper virulence de pathogènes, qui auraient pu rapidement décimer de nombreuses lignées, s’avère plus difficile encore à tester, et manque aujourd’hui cruellement de soutien des données historiques globales. Enfin, l’hypothèse du rôle majeur du changement rapide du climat au cours de la transition Pléistocène-Holocène est également avancée. Elle bénéficie aujourd’hui d’une visibilité plus importante, en vertu des comparaisons établies avec le changement climatique actuel et ses effets désastreux sur la biodiversité.
La fin de la steppe à mammouth
En ce qui concerne les mammouths laineux, même si les hypothèses de la chasse ou de maladies ne peuvent être totalement écartées localement, elles ne sont pas nécessaires à l’explication de leur extinction : pour eux, le facteur environnemental est pleinement suffisant. Au sein de la lignée des éléphantidés, le mammouth laineux constitue l’apex de l’adaptation à un régime alimentaire de brouteur stricte. Il constitue ainsi une forme de vie extrêmement spécialisée, dépendante d’un type unique d’environnement : la si bien nommée « steppe à mammouth », qui n’a que très peu de similitudes avec la toundra glaciaire couvrant désormais les plus hautes latitudes du globe. Le paramètre climatique qui a le plus contribué à la disparition des mammouths n’est sans doute pas autant le réchauffement global des vingt derniers milliers d’années que l’augmentation concomitante de l’humidité. Ainsi, la steppe froide et aride des mammouths s’est progressivement réduite comme peau de chagrin, remplacée au sud par le développement de la taïga moderne, et au nord par celui de la toundra marécageuse, ces deux nouveaux biomes étant impropres à la survie de brouteurs comme les mammouths qui avaient besoin quotidiennement de plus de 100 kg de fourrage. Les populations de mammouths laineux ont progressivement régressé avec leur environnement favori, délaissant au fur et à mesure l’Europe et le sud de la Sibérie, avant de totalement disparaître des continents eurasiatique et américain il y a 10 000 ans environ. Quelques populations reliques ont résisté plusieurs millénaires encore dans les îles de la région du détroit de Béring. Néanmoins, prisonniers d’îlots minuscules, elles ont finalement succombé aux effets délétères de la consanguinité, et la toute dernière population connue s’est éteinte sur l’île de Wrangel, il y a moins de 3 800 ans, tandis qu’à la même époque, les Égyptiens construisaient les temples de Karnak.
Dolly la brebis n’aura pas sa cousine mammouth clonée
Cette extinction signe-t-elle la fin de l’histoire des mammouths ? Sans aucun doute, contrairement à ce que certaines sirènes médiatiques tentent de nous faire croire, aveuglées par les prétentions plus technologiques que scientifiques de quelques « vendeurs de rêve ». Ces derniers ont profité des réussites de clonage animal et de la multiplication des découvertes de carcasses de mammouths momifiées dans le pergélisol du grand nord, pour tenter d’asseoir la possibilité de faire revivre un mammouth via cette technique. Un quart de siècle après l’exposé de leurs ambitions, aucun progrès n’a été fait dans cette voie pour une raison simple : même dans le cas des momifications les plus spectaculaires (comme le mammouth Lyuba découvert en 2007), le génome des mammouths est fragmenté en millions de morceaux, rendant la possibilité de faire fonctionner un noyau de cellule parfaitement illusoire. Prétendre cloner un mammouth est en quelque sorte aussi naïf que d’affirmer qu’une fenêtre minutieusement fracassée continuera de vous protéger du froid et des intempéries.
La seule chose qui soit « colossale » dans cette histoire, c’est l’étendue du mensonge qui nous est présenté.
Une autre colossale illusion : la réécriture génomique
La piste du clonage du mammouth a donc été délaissée, à l’exception de rares « laboratoires » asiatiques qui continuent de promouvoir le clonage animal. Mais une autre piste a depuis vu le jour pour alimenter l’idée de la « désextinction » des mammouths : celle de la réécriture génomique. Cette deuxième voie est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre expérimentalement, et par là même, plus ardue à déconstruire auprès du grand public. En théorie, elle suppose de recomposer la séquence complète désormais connue du génome du mammouth laineux en transformant le génome d’une cellule d’éléphant moderne à l’aide de ciseaux moléculaires (méthode CRISPR-Cas9 et ses dérivés), afin de créer un mammouth synthétique. Depuis deux ans, une start-up américaine nommée Colossal a accumulé un trésor de guerre de plusieurs centaines de millions de dollars en faisant la promotion d’un tel exploit d’ici cinq ans. De façon intéressante, cette compagnie élude systématiquement les voies du fonctionnement scientifique (publications évaluées par les pairs, etc.), qui auraient tôt fait de démasquer la supercherie : outre le fait que l’ambition de réécrire un génome de mammouth est toujours, et de loin, hors de portée des techniques actuelles, cette approche supposerait – comme le clonage – l’utilisation d’un cheptel de mères-porteuses éléphantes aujourd’hui inexistant et qui ne pourra jamais être réuni au vu des effectifs menacés de leurs populations sauvages. Pas avares en idées fumeuses, les défenseurs du projet arguent à l’envi que l’on pourra sinon envisager un développement extra-utérin complet – une technique qui n’existe pas, même pour des espèces dont le développement pré-natal est bien moins long que celui de près de deux ans des éléphants. Enfin, quand bien même une telle créature verrait le jour, il ne s’agirait au mieux que d’une chimère d’éléphant avec quelques traits de mammouth, guère plus convaincante que les effets spéciaux de La Guerre du Feu dans le domaine, et condamnée à s’éteindre sans postérité : il faudrait a minima plusieurs milliers de ces créatures capables de se reproduire pour envisager leur pérennité sur le moyen à long terme. Bref, la seule chose qui soit « colossale » dans cette histoire, c’est l’étendue du mensonge qui nous est présenté.
Sommaire
Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire
5/7. Les derniers mammouths