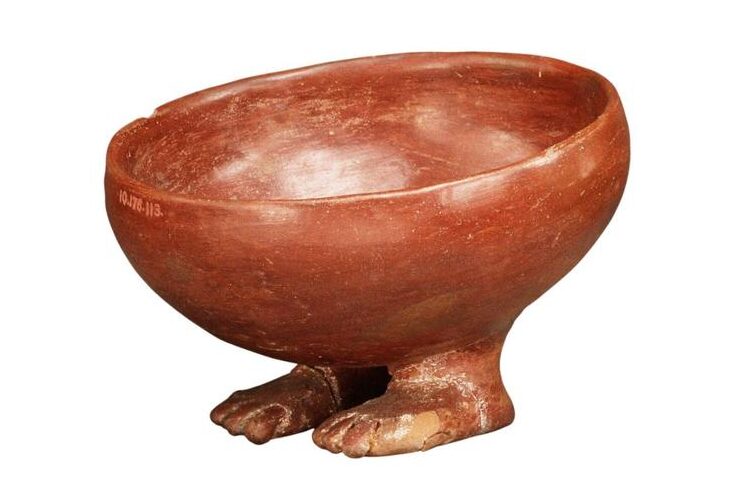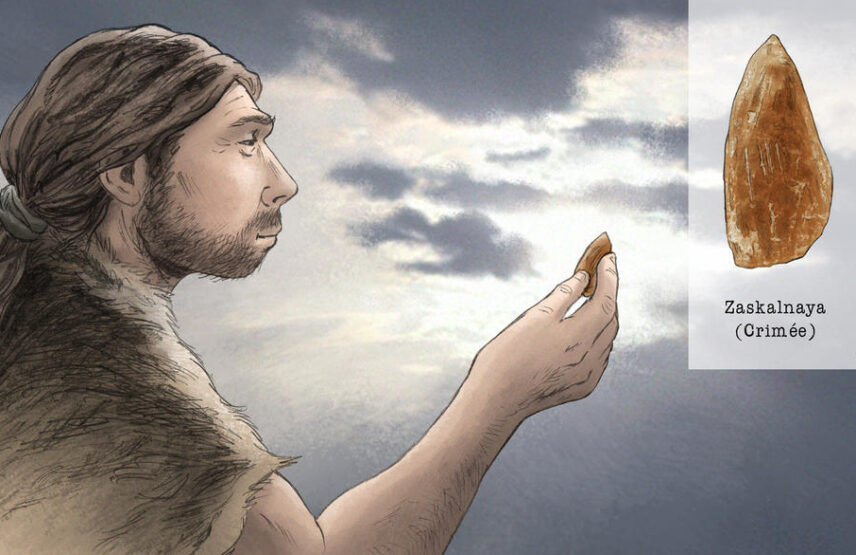Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire (6/7). Dans l’arche de Noé préhistorique

Reconstitution d’un mégacéros (détail). Les Eyzies-de-Tayac, musée national de Préhistoire. © RMN-Grand Palais (musée de la Préhistoire des Eyzies) / Franck Raux
Dès la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle leur existence est connue, les mammouths (du russe mamont) ont passionné les premiers chercheurs. Une fascination qui ne s’est jamais démentie auprès du grand public : la taille de ces pachydermes, la forme de leurs défenses, la longueur de leur trompe et leur abondante fourrure concourent toujours à en faire aujourd’hui les stars des animaux préhistoriques. À l’occasion, fin février 2023, du retour du célèbre mammouth de Durfort au Muséum national d’Histoire naturelle après un an de restauration, Archéologia vous propose un dossier « Mammouth » pour mieux connaître ces pachydermes de la Préhistoire et leurs contemporains tout en faisant la synthèse des derniers apports de la paléontologie.
Les auteurs du dossier sont : Amélie Vialet (auteur et coordinatrice), Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP ; Philippe Fosse et Jean-Philip Brugal, UMR 7269, LAMPEA, université Aix-Marseille ; George Konidaris, université de Tübingen (Allemagne) ; Dimitris Kostopoulos, université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Ran Barkai, université de Tel-Aviv (Israël) ; Frédéric Plassard, responsable de la grotte de Rouffignac, UMR 5199, PACEA, université de Bordeaux ; Régis Debruyne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209, AASPE ; Anne-Marie Moigne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP.
Ce dossier a été conçu en hommage à deux grands paléontologues qui nous ont quittés récemment : Emiliano Aguirre (1925-2021) et Yves Coppens (1934-2022).

Bison polychrome de la galerie principale de la grotte de Font-de-Gaume (Dordogne). © N. Aujoulat, Centre national de Préhistoire / Ministère de la Culture
Les mammouths ont peuplé l’Eurasie pendant plus de 2,5 millions d’années, et ils n’y étaient bien évidemment pas seuls. Ces animaux de grande taille ont évolué au cours des variations du climat, entourés d’une grande diversité d’espèces.
À son arrivée sur les bords de la Méditerranée, le mammouth s’intègre dans des environnements mixtes de savanes et de forêts, propices aux gazelles, aux grands bovidés, aux grands cervidés et aux girafes mais aussi à de très grands herbivores comme les rhinocéros et les anancus (un autre grand proboscidien, disparu) ; les carnivores, nombreux, complètent ce tableau : guépards, panthères, lynx et félins à dents de sabre, grandes hyènes et Pliocrocuta – notamment en Turquie ou en Europe centrale. Dans ce contexte plutôt chaud et humide, la Grèce et l’Italie sont les zones les plus riches en sites, les stratigraphies permettant de suivre précisément la succession des faunes associées aux premiers mammouths.
Changement de climat, changement d’espèces
Les variations climatiques du début du Quaternaire sont très marquées et voient la disparition des nombreuses espèces du Pliocène en Europe, qui sont en partie remplacées par des grands mangeurs d’herbe comme les chevaux sténoniens, les mammouths méridionaux et le rhinocéros étrusque. Cet épisode est d’ailleurs appelé « l’événement à éléphants et chevaux », bien repéré sur les sites italiens et du Massif central ainsi qu’en Espagne où le mammouth méridional est toujours associé à Anancus arvernensis. La faune de cette période présente une biodiversité aussi importante pour les herbivores que les carnivores. Vers la deuxième moitié du Pléistocène inférieur, des nouveaux changements interviennent et de nombreuses espèces africaines parviennent dans le sud de l’Europe et les sites du Levant, du Caucase ou des Balkans – indiquant les voies de migrations empruntées par certains bovins, girafes, hippopotames, chevaux, hyènes ou de nombreuses espèces asiatiques comme les bisons, de nouveaux chevaux et de grands cervidés avec des formes de bois très diverses. Cette impressionnante population d’herbivores favorise la diversité des carnivores. Si les félins à dents de sabre sont toujours actifs, un jaguar est également présent, un lycaon hyper carnivore, un chacal et les loups. Les canidés chassent en meute dans des environnements ouverts, et parmi eux, la plus efficace est sûrement la grande hyène Pachycrocuta brevirostris qui aide, par ses accumulations de carcasses, le charognage des nombreux animaux ainsi que l’apport carné du régime alimentaire des hominines qui arrivent aussi en Europe. Ces assemblages sont très nombreux en Europe méridionale mais aussi plus septentrionale comme à Saint-Prest (à côté de Chartres) en France et à Untermassfeld en Allemagne.

Hyène dans les rochers. © Benoit Clarys
Entre chaud et froid extrêmes
Au Pléistocène moyen, le rythme dans la succession des périodes froides et tempérées ralentit, impliquant parfois des conditions extrêmes de façon durable. Les périodes glaciaires affectent majoritairement l’Eurasie et favorisent un afflux massif d’espèces animales provenant d’Asie où les territoires se réduisent par la progression des zones englacées en Sibérie et dans le nord de l’Europe, et des glaciers dans les zones montagneuses. L’Europe occidentale connaît un afflux de grands mammifères avec comme chef de file le mammouth des steppes, suivi des chevaux caballins, des rhinocéros de prairie et de nombreux bovidés (bisons, bœufs musqués, thars, chamois et mouflons). Des changements ont lieu aussi parmi les cervidés entre les rennes, les cerfs, les grands daims d’Asie et les élans, en fonction du climat plus ou moins humide. Leurs prédateurs (lions, panthères, loups, cuons) les suivent dans ces environnements ouverts où la chasse en meute est plus aisée. Les périodes tempérées et humides favorisent plutôt l’arrivée dans toute l’Europe des éléphants, des hippopotames, des aurochs et des hyènes africaines, parfois des buffles, des macaques ou des ours du Tibet.

Panneau des chevaux et des rhinocéros. Salle Hillaire, grotte Chauvet. © J. Clottes – Centre National de la Préhistoire – Ministère de la Culture
Une biodiversité variée
Si la biodiversité semble être réduite, elle est néanmoins très variée, les grandes séquences fluviatiles d’Allemagne ou d’Angleterre enregistrant des cortèges impressionnants de grandes et de petites faunes. Dans les grottes des grands massifs calcaires, cette baisse est peut-être dû à l’activité et la présence intensive des hominines qui, sans l’aide des grands carnivores de la fin du Pléistocène inférieur, en particulier la grande hyène, ont changé de stratégie et sont devenus des chasseurs. Vers 200 000 ans, de nouveaux migrants s’installent, adaptés à des conditions de plus en plus froides. Le mammouth laineux et le rhinocéros laineux sont maintenant à la tête de ces associations ; le bouquetin occupe les niches écologiques de steppe ou de steppe montagneuse ; l’ours des cavernes (Ursus spelaeus) et le grand loup (Canis lupus) sont les carnivores les plus abondants. Cette alternance de périodes climatiques contrastées, et majoritairement fraîches, se poursuit jusqu’à 125 000 ans environ (début du dernier interglaciaire). À la fin de ce dernier, autour de 75 000 ans, les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros de Merk, les daims, les macaques et les ours du Tibet désertent définitivement la plupart des territoires européens.
Le début du Quaternaire est appelé « l’événement à éléphants et chevaux » en raison de la présence des grands mangeurs d’herbes.
L’âge du Renne
À partir de cette période, le mammouth laineux est bien connu dans tous les pays d’Europe septentrionale et centrale, sous la forme d’ossements fossiles ou de parures et d’outils taillés par les groupes humains dans son ivoire. Il est très souvent accompagné de grands mammifères (comme le rhinocéros laineux) et de grands bovidés (tels les bisons et l’aurochs – qui est bien figuré dans la grotte de Lascaux et devient le seul grand bovidé à la disparition des grands bisons). À leur côté se trouvent le bœuf musqué, qui a colonisé les plaines d’Europe et s’est développé jusqu’à la façade atlantique, et l’antilope saïga, qui migre, via les grandes plaines dégagées lors de l’abaissement du niveau de la mer au niveau de la Manche, vers le Bassin aquitain et le plateau continental du Languedoc. Les derniers grands chevaux du Pléistocène moyen sont remplacés par plusieurs types de chevaux asiatiques, plus petits et mieux adaptés à une végétation de steppe très froide ou à des environnements de zones humides. Les cervidés sont toujours bien représentés par les rennes. Si l’époque du mammouth laineux peut aussi être appelée « l’âge du Renne », les élans apparaissent aussi dans de nombreux sites, comme les mégacéros ou grands cerfs des tourbières et les cerfs, proies privilégiées des chasseurs et des grands carnivores. Les chevreuils sont rares et identifiés dans les sites en contexte forestier dominant. Dans les zones montagneuses où les mammouths sont plus rares, les bouquetins comme les chamois occupent les sommets. Les ours des cavernes sont abondants dans les massifs montagneux d’Eurasie. Leur taille augmente régulièrement et leur régime alimentaire devient de plus en plus végétarien ; de plus en plus rare à partir du maximum glaciaire, l’ours des cavernes disparaît dans le massif de la Chartreuse il y a 14 000 ans tandis que l’ours brun, omnivore, plus discret dans les sites, en reste l’unique représentant.

Reconstitution d’un mégacéros. Les Eyzies-de-Tayac, musée national de Préhistoire. © RMN-Grand Palais (musée de la Préhistoire des Eyzies) / Franck Raux
Pour aller plus loin
COPPENS Y., 2018, Origines de l’Homme, origines d’un homme. Mémoires, Paris, Odile Jacob. Mammouths ! Des géants en vallée de l’Eure, catalogue d’exposition sous la direction de DUPONT F., VIALET A., GUINGUENO M., MOIGNE A.-M., 2022, édition Mairie de Chartres
Table-ronde « Mammouths », Chartres, les 3 et 4 février 2022 : www.youtube.com/playlist?list=PLvIL0a6_w83bMcr7Sk9iLR8vcK2UDR0c0
Sommaire
Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire
6/7. Dans l’arche de Noé préhistorique