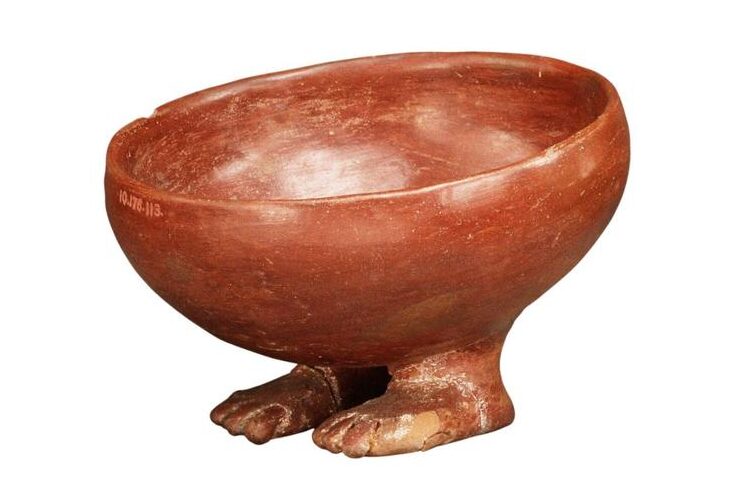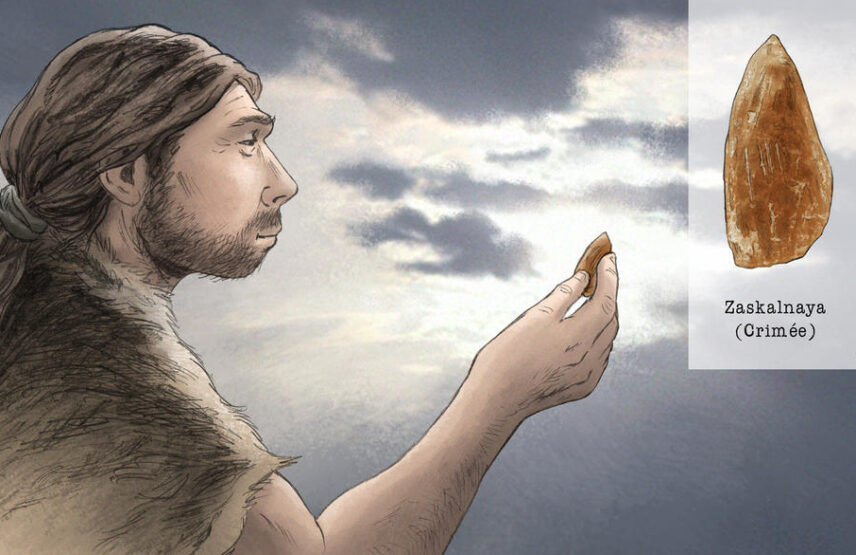Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire (7/7). « Monsieur Mammouth » : hommage à Yves Coppens

Yves Coppens en 2014 (détail). Yannick Coupannec. All rights reserved 2023 / Bridgeman Images
Dès la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle leur existence est connue, les mammouths (du russe mamont) ont passionné les premiers chercheurs. Une fascination qui ne s’est jamais démentie auprès du grand public : la taille de ces pachydermes, la forme de leurs défenses, la longueur de leur trompe et leur abondante fourrure concourent toujours à en faire aujourd’hui les stars des animaux préhistoriques. À l’occasion, fin février 2023, du retour du célèbre mammouth de Durfort au Muséum national d’Histoire naturelle après un an de restauration, Archéologia vous propose un dossier « Mammouth » pour mieux connaître ces pachydermes de la Préhistoire et leurs contemporains tout en faisant la synthèse des derniers apports de la paléontologie.
Les auteurs du dossier sont : Amélie Vialet (auteur et coordinatrice), Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP ; Philippe Fosse et Jean-Philip Brugal, UMR 7269, LAMPEA, université Aix-Marseille ; George Konidaris, université de Tübingen (Allemagne) ; Dimitris Kostopoulos, université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Ran Barkai, université de Tel-Aviv (Israël) ; Frédéric Plassard, responsable de la grotte de Rouffignac, UMR 5199, PACEA, université de Bordeaux ; Régis Debruyne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209, AASPE ; Anne-Marie Moigne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP.
Ce dossier a été conçu en hommage à deux grands paléontologues qui nous ont quittés récemment : Emiliano Aguirre (1925-2021) et Yves Coppens (1934-2022).

Évocation d'un mammouth laineux dans la neige. © akg-images / Leonello Calvett / Science Photo Library
« Monsieur Mammouth », c’est le surnom donné par Jean-Pierre Lehman, le professeur de paléontologie du Muséum national d’Histoire naturelle, au jeune Yves Coppens qui vient tout juste d’arriver, en 1956, dans le sillage du professeur Jean Piveteau. Dès lors, son chemin scientifique, s’il semble tracé sous le signe des mastodontes, sera jalonné d’événements tout aussi inattendus qu’extraordinaires.
En effet, c’est d’abord le remontage d’un spécimen envoyé de Sibérie, en 1912, puis oublié dans les caisses de l’établissement, qui lui sera confié. Ce mammouth d’Atrikanova constitue la pièce maîtresse d’une exposition présentée au public en galerie de botanique au Jardin des Plantes. Et quelques années plus tard, en 1969, il s’offrira au regard des badauds étonnés au sein de la Maison de la Radio pour célébrer le 10e anniversaire de la Fondation de la Vocation. Entre temps, Yves Coppens a saisi l’opportunité d’étudier en détail l’anatomie d’une éléphante décédée au Parc zoologique de Vincennes. C’est l’histoire de la dissection de « Micheline » qu’il a si souvent relatée tant l’opération semblait aussi intéressante qu’incongrue étant donné la taille difficilement gérable de l’animal.
De l’Éthiopie…
Et puis viennent les années africaines, le Tchad tout d’abord et l’Éthiopie ensuite, terres de découvertes, notamment d’éléphantidés. Dans la vallée de l’Omo, ces derniers vont lui permettre une brillante démonstration des changements climatiques au cours du temps. En effet, les découvertes effectuées dans les différentes strates de la formation de Shungura empilées sur près d’un kilomètre d’épaisseur montrent clairement un changement dans la morphologie dentaire de ces grands animaux, dans la cohorte des faunes et même, à l’échelle microscopique, dans la composition de la flore, indiquant une aridification croissante, entre 3 et 1 millions d’années. Ces observations sont à l’origine des théories formalisées plus tard, dans les années 1980, de l’East Side Story et de l’(H)Omo event établissant un lien entre les changements climatiques, l’évolution des pré-humains et l’émergence de notre genre Homo. C’est également en Éthiopie, dans ce territoire reçu en héritage de son maître Camille Arambourg, qu’Yves Coppens co-découvrira le fossile de Lucy, Australopithecus afarensis de 3,5 Ma, devenu une véritable star médiatique internationale.
… à la Sibérie
Loin de l’Afrique sub-saharienne, ses terrains plus récents seront ceux de la Sibérie, comme un clin d’œil à son début de carrière au Muséum, à l’invitation de l’explorateur Bernard Buigues qui donne lieu, en 1999, au spectaculaire dégagement et à l’hélitreuillage du mammouth congelé de Jarkov. Plus modestement, en nous accompagnant dans la révision de la collection paléontologique de Saint-Prest et sa présentation au public au musée des Beaux-Arts de Chartres, de février à juin 2022, le professeur Yves Coppens revenait là encore à ses premières amours. Il avait, en effet, décrit avec Michel Beden, en 1982, ces abondants fossiles de mammouth, parcourant la vallée de l’Eure il y a environ 800 000 ans, comme les derniers représentants de l’espèce Mammuthus meridionalis depereti. Voici un résumé de quelques faits marquants de la carrière d’un chercheur exceptionnel, à la passion communicative, passé des collections au terrain, et, sans cesse, des mammouths aux humains !

Yves Coppens en 2014. © Yannick Coupannec. All rights reserved 2023 / Bridgeman Images
Sommaire
Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire
7/7. « Monsieur Mammouth » : hommage à Yves Coppens