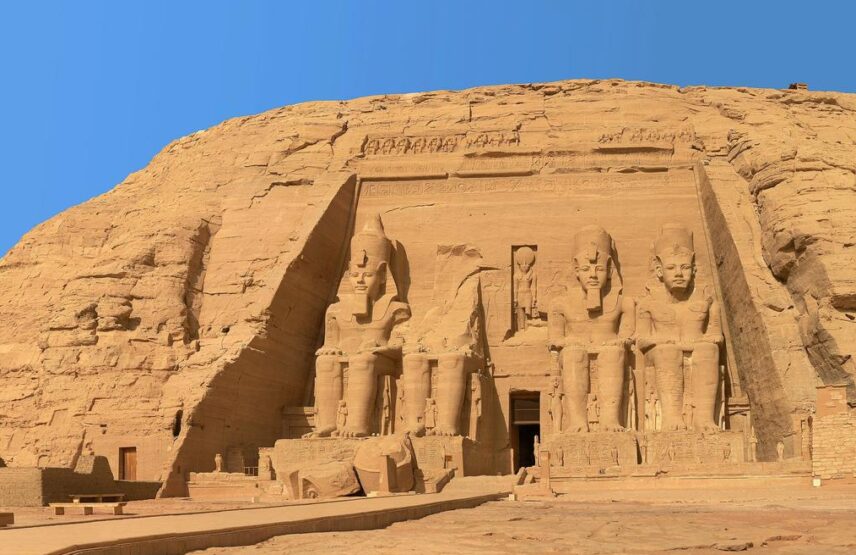Les défunts de l’hôpital de Navarre à Évreux

Vue de l’ancien cimetière de l’hôpital de Navarre. © Anne-Sophie Vigot, Éveha
Au sud-ouest d’Évreux, l’ancien cimetière de l’hôpital de Navarre a été en usage entre 1866 et 1976. Aujourd’hui situé sur le tracé de la déviation projetée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, il vient de faire l’objet de fouilles partielles. Cette opération est exceptionnelle en raison du caractère extrêmement récent des inhumations, qui soulève des questions éthiques et a conduit à la mise en place d’un protocole spécifique. Explications d’Anne-Sophie Vigot, archéologue à Éveha qui a supervisé le chantier, en 2024.
Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier
Pouvez-vous nous présenter les spécificités de ce cimetière et le périmètre des fouilles ?
Ce cimetière est créé à la suite d’une épidémie de choléra quelques mois après l’ouverture de l’hôpital psychiatrique en 1866. Il a parfois été désigné comme celui « des indigents » – car l’hôpital accueillait également des pauvres – ou encore « le Champ du repos ». La dernière inhumation a eu lieu en 1976, et l’espace funéraire, qui forme un grand carré divisé en quatre secteurs, a été désacralisé en 2010. Le projet de contournement routier imposait de déplacer les quelque mille sépultures qu’il abritait. Toutes n’ont pas fait l’objet d’une fouille en tant que telle : celle-ci avait été prescrite, à la suite des sondages, sur quatre zones seulement. En revanche, nous avons réalisé un relevé topographique de l’ensemble, ainsi que des observations archéologiques sur l’intégralité des tombes : disposition des ossements, espaces de décomposition, vestiges de cercueils, mobilier funéraire, etc. Pour conserver la mémoire de l’agencement spatial et pouvoir réattribuer les identités, nous avions auparavant procédé à un relevé de tous les marqueurs de surfaces (croix, stèles, monuments). Au-delà de la fouille proprement dite, nous avons mené un accompagnement du service de pompes funèbres pendant tout le temps de l’exhumation des défunts dont les sépultures n’étaient pas fouillées.

Deux tombes se recoupant dans l’ancien cimetière de l’hôpital de Navarre. © Juliette Bourry, Éveha
Le caractère récent d’un certain nombre d’inhumations a-t-il imposé une procédure particulière ?
L’opération a été précédée, bien en amont, d’un appel aux descendants, diffusé aussi largement que possible, par voie de presse, affichage sur les portes du cimetière, travaux de recherche menés par des lycéens… Seules 14 familles se sont manifestées au final. Il faut dire que les patients de l’hôpital étaient souvent déjà, de leur vivant, un peu oubliés ; les registres ne remontaient par ailleurs qu’à 1936 ; et par manque d’entretien, un certain nombre de sépultures n’était pas identifiable. Les descendants ont pu exprimer leur souhait quant au devenir de la dépouille de leur proche. Parmi eux, l’arrière- petite-fille d’une dame de confession juive, qui avait été cachée par les religieuses de l’hôpital et que son fils, revenu de déportation, avait cru morte pendant la guerre, a découvert que son aïeule avait en réalité vécu jusqu’aux années 1970 ; elle a choisi de donner le corps de sa parente à l’archéologie. Sur le terrain, cette opération avait une charge émotionnelle particulière : les sépultures que nous avons fouillées étaient, temporellement, celles de la génération de nos grands-parents, et nous pouvions redouter ce que nous allions mettre au jour.

Tissus synthétiques non décomposés mis au jour dans une sépulture. © Amélie Desrues, Éveha
Avez-vous été surpris par les découvertes ?
Contrairement aux attentes, les corps étaient tous squelettisés. Quelques cheveux étaient encore présents, mais de manière anecdotique. Tous les vêtements s’étaient décomposés, sauf ceux en matière synthétique. Sans surprise en revanche au vu de la condition sociale généralement modeste des défunts, le mobilier funéraire était peu abondant : petites croix, crucifix initialement placés sur le dessus des cercueils, peignes à cheveux, médailles, alliances, ou encore éléments de couronnes mortuaires ornées de perles remontant aux années 1900-1920… Nous avons également retrouvé des prothèses médicales métalliques, de hanche notamment.

Médaille militaire mise au jour dans une sépulture. © Alizée Guérin Chaubard, Éveha
Qu’ont révélé les fouilles sur la composition de la population inhumée et les pratiques funéraires ?
C’est une population composée presque exclusivement d’adultes (il n’y a en tout et pour tout que 3 ou 4 enfants/adolescents), hommes comme femmes, patients, soignants ou religieux, ce qui correspond à la communauté qui vivait au sein de l’hôpital. Nous avons pu déterminer six phases d’occupation successives, les tombes faisant alors l’objet d’un relèvement, suivi d’un dépôt au sein de l’ossuaire collectif ; à partir des années 1930-1940, en revanche, les ossements étaient – à en juger par le four crématoire qui semble dater de cette période – incinérés. Ce qu’il en restait à l’issue du processus était réenfoui au sein d’une tombe.
Quels sont les apports d’une opération de ce type ?
Au-delà de la gestion de l’espace funéraire avec ce four crématoire sans équivalent connu, l’un de ses intérêts majeurs et particulièrement novateurs réside dans la possibilité d’identifier un bon nombre d’individus et de croiser leur étude paléo-anthropologique avec leur dossier médical – un travail réalisé en partenariat avec des médecins légistes. Sur le terrain, la collaboration avec les pompes funèbres REBITEC a été une belle expérience humaine et une forme d’archéologie expérimentale. Il était très précieux d’observer leurs gestes. Et il s’avère qu’ils sont proches de ceux de leurs prédécesseurs – que nous nous attachons, en tant qu’archéo-anthropologues, à reconstituer quand nous fouillons des sépultures.