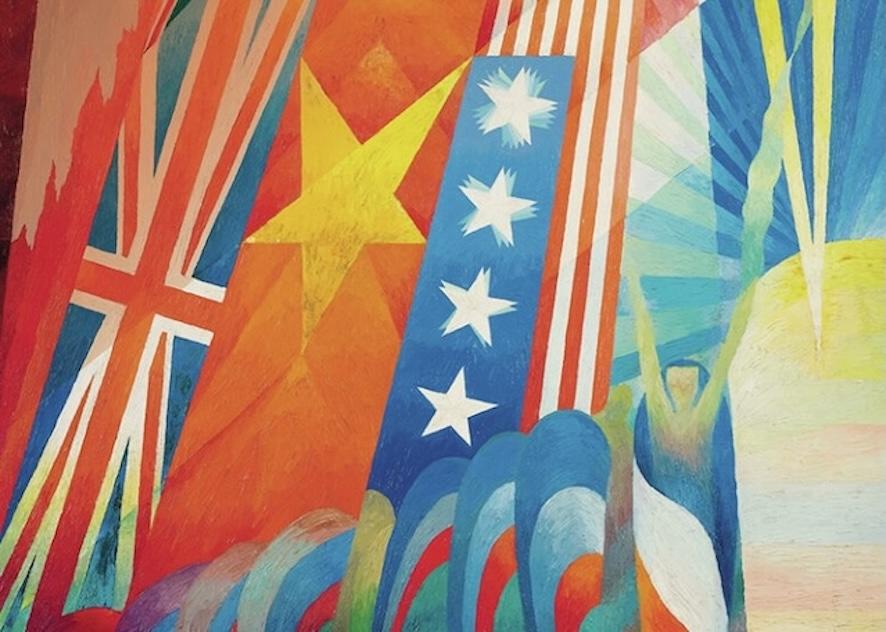Avis aux bibliophiles : notre sélection de beaux livres

Des ressorts du collectionnisme à la notion de livre pauvre en passant par l’histoire de l’imprimerie : voici une sélection d’ouvrages qui raviront les bibliophiles.
Deux siècles de galeries d’art en France
Trop souvent réduites, aux yeux du grand public, au simple rôle d’intermédiaire commercial, les galeries sont pourtant au cœur des réalités du marché de l’art : rouage nécessaire entre artistes et collectionneurs, elles font partie d’un écosystème qui lie considérations esthétiques et techniques et enjeux économiques. C’est ce que démontre ce dense ouvrage de synthèse dont les textes, dus à cinq spécialistes, permettent une mise au point de l’état de l’art : on y découvre les subtilités d’un marché qui se transforme depuis le XIXe siècle sous les coups de boutoir des évolutions sociales et des expérimentations artistiques, où les relations complexes entre acteurs divers, artistes, collectionneurs, critiques et marchands déterminent les tendances de demain. Le volume, très complet dans son propos, est aussi abondamment illustré de documents variés : reproductions d’œuvres d’art, photographies, gravures, coupures de presse, caricatures et archives jalonnent les essais contant cette riche histoire des galeries – des marchands de curiosités du milieu du XIXe siècle aux community managers d’aujourd’hui, en passant par l’influence de l’industrialisation et du capitalisme sur le marché de l’art naissant. R. B.-R.

Julie Verlaine, Nathalie Moureau, Alice Ensabella, Léa Saint-Raymond, Agnès Penot, Histoire des galeries d’art en France du XIXe au XXIe siècle, Flammarion, 2024, 544 p. Prix : 38 €.
Ce que collectionner veut dire
Après deux premiers volumes parus en 2020, Collectionneurs & Psyché et Collectionneurs & Musées, la Wittockiana publie deux nouveaux ouvrages proposant également un florilège d’essais explorant les ressorts les plus divers du collectionnisme. Ces deux additions à la série « Ce que collectionner veut dire » rassemblent ainsi des textes savants de la plume d’experts renommés. Croisant considérations esthétiques, sociales et financières, ils initient le lecteur aux subtilités d’une histoire liée à celle des sociétés modernes et à l’essor du capitalisme. L’ancienne bibliothèque personnelle du grand bibliophile belge Michel Wittock, aujourd’hui écrin du musée de la Reliure et des Arts du livre, a réuni régulièrement pendant quatre années des journées d’études, dont les travaux sont publiés ici. Le format léger rend particulièrement agréable la lecture de textes variés, alternant articles exigeants et entretiens informels. Les deux ouvrages, illustrés par quelques photographies et schémas explicatifs, complètent remarquablement, par leur propos densément documenté, cette tétralogie consacrée à la passion du livre et des objets d’art, à son histoire et à ceux qui la font vivre. R. B.-R.

Géraldine David et François Mairesse (dir.), Collectionneurs & Artistes (123 p.) et Collectionneurs & Marché (144 p.), coll. « Ce que collectionner veut dire », Wittockiana, 2024. Prix : 15 € chacun.
L’imprimerie, matrice des sociétés
« L’imprimerie ne cessera d’être l’instrument de la vérité, si elle n’est la vérité elle-même. » Ces mots du lexicographe Joseph Décembre semblent fondés, tant l’histoire de l’imprimerie, telle que racontée dans cet ouvrage d’Olivier Deloignon, s’écrit au gré des revendications sociales, philosophiques et religieuses, depuis le XVe siècle et la Réforme protestante jusqu’aux fanzines de l’époque contemporaine. L’auteur, docteur en histoire de la typographie, revient sur l’évolution du regard de ceux qui côtoient le livre et l’imprimé, mais aussi sur la dimension hautement politique de cette technologie. L’accès facilité au texte bouleverse les équilibres économiques, intellectuels et les hiérarchies sociales d’une Europe qui se prémondialise et voit l’essor des langues vernaculaires, au détriment du grec et du latin, autrefois réservés à une élite, tandis que les docteurs de l’Université, les libraires et les confréries d’imprimeurs luttent âprement pour une place dans ce commerce du savoir. Olivier Deloignon parvient ici, au fil d’une étude approfondie des cheminements de cinq siècles d’imprimerie, à restituer avec clarté cette riche histoire sans en négliger les zones d’ombre… à commencer par une minutieuse contre-enquête sur son véritable inventeur. R. B.-R.

Olivier Deloignon, Une histoire de l’imprimerie et de la chose imprimée, La Fabrique, 2024, 328 p. Prix : 16 €.
Le livre pauvre
Après plusieurs publications de Daniel Leuwers, poète, critique littéraire et « inventeur » du livre pauvre, voici une étude approfondie sur le sujet issue du master recherche en histoire de l’art de Julien Michel. Scandé en trois chapitres, « la création pauvre, livre ou œuvre ? », « jeux et enjeux du dépouillement povériste » et « le livre pauvre à l’épreuve de son isolement », ce petit ouvrage propose de faire le point sur l’identité du livre pauvre : « Les presque 3 000 titres de livres pauvres qui existent aujourd’hui nourrissent une inédite variété de formes, qui rendent la définition du genre compliquée », précise-t-il. Le définir par ce qu’il n’est pas – ni livre de bibliophilie ni livre d’artiste – est évidemment insuffisant. Son aspect « pauvre », puissamment revendiqué, renvoie d’une part à son mode de création : il s’agit souvent d’un feuillet unique, plié plusieurs fois, portant des vers manuscrits par un poète accompagnés par les interventions d’un artiste et réalisé à quelques exemplaires. Et, d’autre part au fait qu’il n’entre dans aucun circuit économique puisqu’il n’est pas « fait » pour être commercialisé mais peut être exposé. Une passionnante analyse, qui n’enferme pas le livre pauvre dans des catégories définitives. M. A.

Julien Michel, Le Livre pauvre. Identité trouble, identité double, Presses universitaires du Midi (PUM), 2024, 62 p. Prix : 14 €.
Feng Zikai
Feng Zikai (1898-1975) est, en Chine et dans le vaste domaine de l’histoire de la peinture, un incontournable créateur. Contemporain de Matisse, d’Utrillo et de Chagall, il a laissé une œuvre riche de dessinateur, de peintre et d’écrivain qui n’a pas manqué d’influencer nombre d’artistes dans le monde. Cette monographie montre l’ampleur de son talent et la variété des médiums qu’il appréciait. Yin Wenying, agrégée de chinois, et Christophe Comentale, historien de l’art et conservateur en chef honoraire sinisant, ont conjugué leurs efforts pour cette première édition d’un beau livre en français sur Feng Zikai. Comme l’a souhaité Yin Wenying, aux commentaires des auteurs s’ajoutent ceux des proches, ainsi que des souvenirs de plasticiens et de gens de lettres contemporains du peintre. Pour l’iconographie, Christophe Comentale a complété le corpus de l’artiste par des œuvres de comparaison choisies dans l’art extrême-oriental et occidental, lui donnant une place méritée dans l’histoire internationale. Le public curieux d’un art chinois contemporain pourra ainsi faire connaissance avec la délicatesse de cette personnalité alliant le sens de l’observation et l’engagement au service de la vie. S. C.

Christophe Comentale et Yin Wenying, Feng Zikai. Du noir à la couleur, préface Nicolas Idier, postface Feng Nanying et Feng Yiqing, Le Chantier, 2024, 185 p. Prix : 38 €.
Kawase Hasui
Cette belle monographie, abondamment illustrée, consacrée à Kawase Hasui (1883-1957), entraîne le lecteur dans la création d’un peintre et graveur japonais attiré par des sujets traditionnels – ici, le paysage – qu’il traite de manière novatrice. Brigitte Koyama-Richard, professeur émérite à l’université Musashi à Tokyo, dessine le parcours de ce représentant du mouvement Shin hanga – nouvelles estampes du XXe siècle – et le replace dans le contexte de son temps : influence de ses pairs, amitié avec Watanabe Shôzaburô, créateur de ce mouvement et éditeur d’estampes, ou encore ouverture à l’ère Meiji, qui lui permet d’apprendre l’histoire de la peinture occidentale. Artiste voyageur, il parcourt l’archipel qu’il dessine sans relâche et donne ses créations, sous la houlette d’un éditeur, à un graveur sur bois puis à un imprimeur qui tire des œuvres très colorées. Couchers de soleil, paysages enneigés, reflets d’eau, clarté du jour ou obscurité du crépuscule, Hasui sait capter l’atmosphère d’un lieu et le restituer avec grande poésie. Les paysages naturels sont parfois ponctués d’édifices et de figures humaines saisies dans leur activité : musiciens, laveuses de linge, promeneurs… Avis aux amateurs d’estampes japonaises ! M. A.

Brigitte Koyama-Richard, Kawase Hasui. Le poète du paysage, Scala, 2024, 272 p., 400 ill. Prix : 49,90 €.