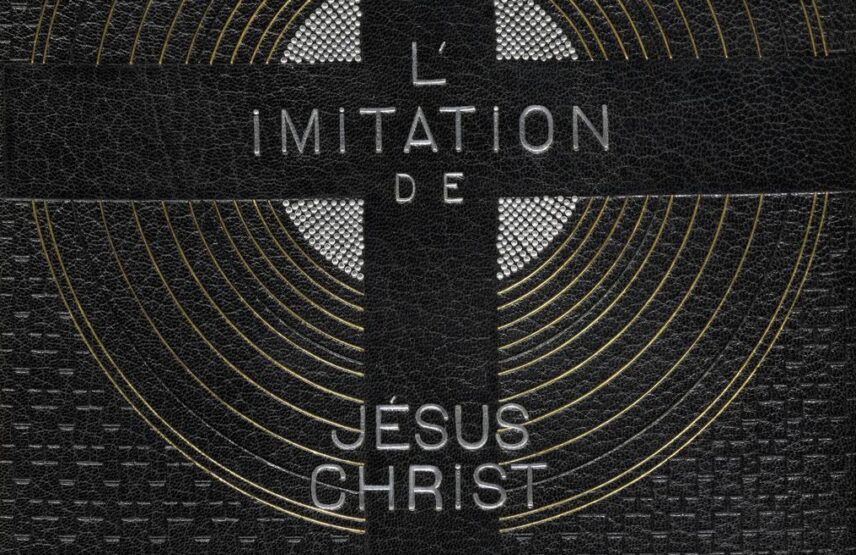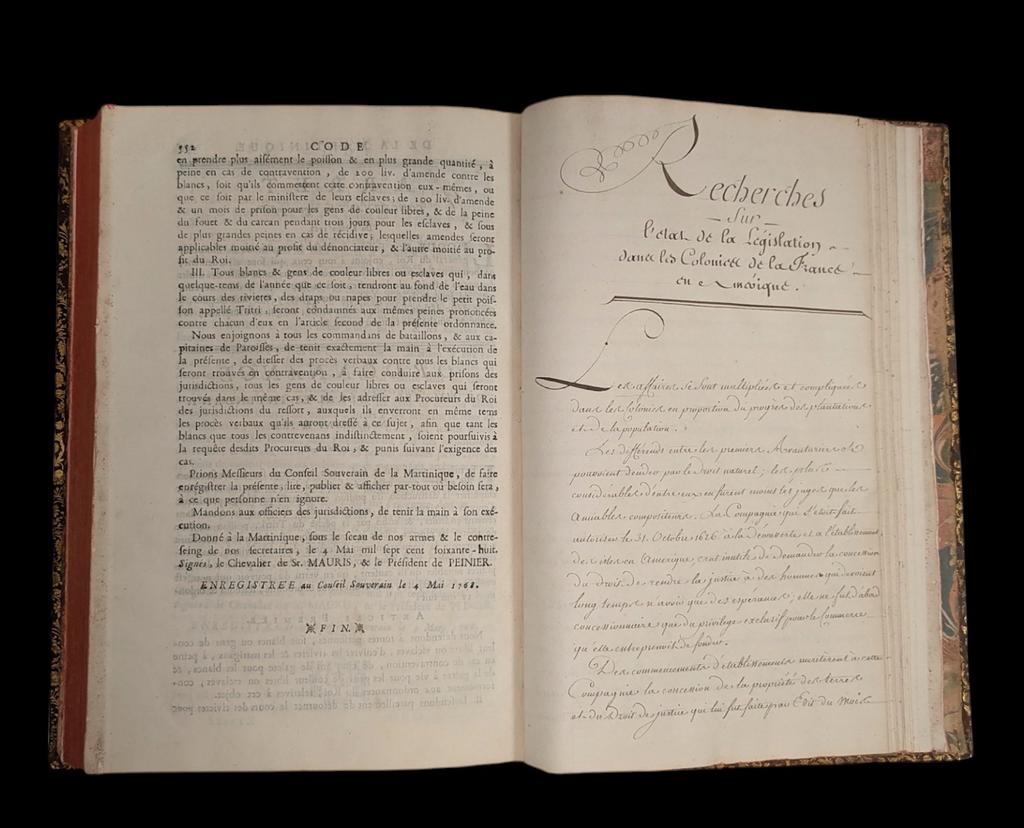Imprimer ! La Bibliothèque nationale de France raconte l’Europe de Gutenberg (1450-1520)

Biblia latina (Bible de Gutenberg) imprimée sur parchemin par Johannes Gutenberg et Johann Fust à Mayence, vers 1455 (détail). © BnF, Réserve des livres rares
L’invention de l’imprimerie, permettant une large diffusion du savoir par le texte et l’image, a constitué une véritable révolution. À travers des pièces exceptionnelles issues en majorité de ses collections, la Bibliothèque nationale de France retrace l’histoire de son développement au XVe siècle et au tout début du XVIe siècle, sans omettre d’évoquer les procédés d’impression en Chine ou en Corée qui ont précédé ceux du génial Gutenberg à Mayence. Entretien avec les deux commissaires de l’exposition, Nathalie Coilly, conservatrice en chef des bibliothèques, chargée de collections incunables à la Réserve des livres rares, et Caroline Vrand, conservatrice du patrimoine, chargée des estampes des XVe et XVIe siècles au département des Estampes et de la Photographie.
Propos recueillis par Claire L’Hoër

Fac-similé d’une presse à imprimer en bois de l’époque de Gutenberg, 1925, Schnellpressenfabrik Frankenthal Alter & Co. © Mayence, Gutenberg-Museum
Comment l’idée de cette exposition est-elle née ?
Nathalie Coilly : Il y a 40 ans, la BnF a entrepris d’établir le catalogue des incunables – livres imprimés entre 1450 et 1500 – comme de nombreuses autres bibliothèques régionales et étrangères. Cet énorme travail, souterrain et très long, pouvait difficilement être montré au public. En revanche, l’exposition que nous présentons aujourd’hui nous permet de donner un état éloquent de cette recherche menée au total par une dizaine de personnes. Cet événement est l’occasion pour le grand public de s’approprier ces livres qui sont les premiers imprimés. La Bibliothèque nationale de France en possède près de 13 000 exemplaires, ce qui en fait la troisième collection au monde après la Bayerische Staatsbibliothek de Munich et la British Library de Londres. C’est une collection très variée dans laquelle se trouvent principalement des livres allemands, italiens et français, et qui sont l’illustration d’une histoire qui traverse toute l’Europe.
Caroline Vrand : Le projet a été conçu initialement par Nathalie Coilly, qui a apporté son expertise et a rapidement eu l’ambition d’y inclure largement les problématiques liées à l’image imprimée, induisant un partenariat entre la Réserve des livres rares et ses incunables et le département des Estampes. Le livre imprimé et les images imprimées sont deux domaines de recherche souvent cloisonnés ; à travers cette exposition, nous avions l’occasion de rassembler ces deux univers.
« Le parcours s’articule d’ailleurs autour de la reconstitution d’un atelier du XVe siècle où seront effectuées des démonstrations d’impression devant le public des visiteurs […] »
Comment le parcours de l’exposition est-il structuré ?
N. C. : L’exposition déroule le fil chronologique d’une histoire qui touche une bonne partie de l’Europe, mais elle s’articule également autour de certaines idées majeures. C’est tout d’abord la mise en évidence du creuset technologique qui a permis l’émergence de l’invention de Gutenberg au milieu du XVe siècle. C’est ensuite l’idée d’aller de l’atelier vers l’étal de livres et les lecteurs en mettant en avant les conséquences sociales et économiques de cette invention. Le parcours s’articule d’ailleurs autour de la reconstitution d’un atelier du XVe siècle où seront effectuées des démonstrations d’impression devant le public des visiteurs car nous tenons beaucoup à la dimension didactique du propos. L’exposition se termine par la présentation de l’édit de Worms de 1521, un grand « placard » imprimé de 1,20 m de haut, par lequel l’empereur Charles Quint interdit la lecture et la diffusion des thèses protestantes de Martin Luther. Pourtant, on le sait, l’imprimé a largement contribué à l’expansion de la Réforme.

Biblia latina (Bible de Gutenberg) imprimée sur parchemin par Johannes Gutenberg et Johann Fust à Mayence, vers 1455. © BnF, Réserve des livres rares
D’où proviennent les pièces exposées ?
C. V. : Sur les 250 pièces exposées, la majorité provient des fonds de la Bibliothèque nationale de France – Réserve des livres rares, département des Estampes, bibliothèque de l’Arsenal, département des Manuscrits et département des Monnaies et Médailles. D’autres institutions françaises nous ont prêté certains documents comme le musée de Cluny, la bibliothèque Mazarine ou encore la bibliothèque municipale de Reims qui possède le plus ancien « placard » illustré français. Enfin, le musée Gutenberg de Mayence nous prête notamment le fac-similé d’une presse de l’époque de Gutenberg, reconstituée à partir de données historiques les plus précises possible. Viennent également du Kunstmuseum de Bâle deux objets très rares : deux matrices en bois datant des années 1490 dont le dessin est attribué à Albrecht Dürer et qui rendent compte de l’importance de la ville de Bâle, très active dans la production de livres imprimés, particulièrement ceux illustrés. Elles devaient servir à l’illustration d’un ouvrage de l’auteur latin Térence mais, finalement, le projet éditorial a été abandonné et les matrices n’ont pas été utilisées.

Jean-Antoine Laurent (1763-1832), Gutenberg inventant l’imprimerie, 1831. Huile sur toile. © Ville de Grenoble / musée de Grenoble – J.-L. Lacroix
Existe-il des exemples de textes imprimés avant Gutenberg ?
C. V. : L’exposition est centrée sur l’Europe, mais nous ne pouvions pas faire l’impasse sur l’Asie, où naît l’imprimerie au VIIIe siècle avec l’invention de la xylographie. Nous présentons quelques pièces très importantes de l’histoire de l’imprimerie asiatique, en particulier le Jikji, ouvrage imprimé en Corée en 1377, qui est le premier livre daté à recourir à des caractères métalliques mobiles. L’exposition présente également une matrice en bois gravée en Chine au VIIIe siècle. Tous deux sont conservés au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.
N. C. : Cependant, on peut observer que les caractères mobiles, s’ils fonctionnent particulièrement bien pour un alphabet simple et court, ne sont pas forcément très opérationnels pour des sinogrammes. Ce qui explique peut-être que la technique xylographique est restée très prisée en Asie, d’autant que le bois gravé permet de rester proche du trait du calligraphe et d’éviter les coquilles dans les textes religieux bouddhiques à valeur de rituels.

Päk un (1298-1374), Päk un hoa sañ č’orok bulčo č’ikč’i simč’e yočōl (Jikji), imprimé dans le temple Heung Deok en Corée, 1377. © BnF, département des Manuscrits
En quoi consiste le rôle de Gutenberg dans la mise au point de l’imprimerie à Mayence vers 1450 ? En quoi la pratique de l’estampe a-t-elle influencé l’imprimerie ?
C. V. : Gutenberg n’est pas un génie solitaire, il n’est pas déconnecté de ce qui se passe en Europe à son époque. D’autres typographes travaillent dans le même sens que lui. Il fait son miel des différentes techniques qui l’ont précédé. Dans la section sur les prémices, nous revenons sur tout ce qui précède l’invention de Gutenberg, car on sait imprimer par xylographie en Europe dès les années 1400, cinquante ans avant la période qui nous intéresse, particulièrement en Europe centrale – Allemagne du Sud, Bohême-Moravie. Le plus ancien bois gravé connu date de 1420, c’est le « bois Protat ». Ensuite, dès les années 1440 est mise au point la technique de la gravure sur cuivre, en taille douce, mais cette fois dans la vallée du Rhin. Nous sommes alors dans la même aire géographique que celle de Gutenberg, qui a forcément eu connaissance de ces innovations. À la même époque, on commence à voir apparaître des images xylographiques accompagnées de texte gravé sur la même matrice en bois. C’est souvent une grande image voisinant avec un texte court mais, dans l’exemple des « bibles des pauvres », c’est une véritable imbrication entre image et texte explicatif dans de petites bulles. Dans cette première partie de l’exposition, nous présentons donc les plus anciennes images imprimées européennes. De plus, le but de l’exposition est aussi de montrer le grand nombre d’inventions qui sont apparues à cette époque d’effervescence, et dont certaines n’ont pas survécu : il n’y a pas eu que des réussites dans le domaine de la typographie.

Bois gravé dit « bois Protat », Crucifixion, vers 1420, Allemagne du Sud. Bois de noyer gravé en relief. © BnF, département des Estampes et de la Photographie
N. C. : Selon plusieurs sources contemporaines, Gutenberg apparaît comme celui qui parvient à s’approprier des techniques existantes en leur donnant une nouvelle finalité. Par exemple, on sait que, lorsqu‘il était à Strasbourg avant de revenir à Mayence, il maîtrisait la fonte d’un alliage plombifère qui lui servait à fabriquer des petites enseignes métalliques selon le même procédé que celui utilisé pour la fonte des caractères typographiques. Il possédait également une presse sur laquelle il menait des expérimentations secrètes. Gutenberg a fait la jonction entre des procédés du travail métallurgique et des procédés des arts graphiques. Vers 1471, Guillaume Fichet, théologien et humaniste parisien, désigne nommément Gutenberg comme l’inventeur de cette nouvelle technique. Et il est probable que la plupart des tout premiers typographes ont eu un contact direct avec Mayence ou avec Gutenberg.

Erhard Reuwich (1445-1505), Vue de Venise, dans Bernhard von Breydenbach (v. 1440-1497), Opusculum sanctorum peregrinationum ad spulcrum Christi, imprimé sur parchemin à Mayence par Peter Schöffer pour Erhard Reuwich en 1486. Gravure sur bois en relief. © BnF, Réserve des livres rares
Pouvez-vous nous parler des deux exemplaires de la bible de Gutenberg qui sont exposés ?
N. C. : Dès la fin du XVIIIe siècle, cette célèbre bible est désignée comme celle fabriquée par Gutenberg mais la preuve scientifique formelle n’a été donnée qu’au XIXe siècle. La Bibliothèque nationale de France a la chance de posséder deux exemplaires de ce livre exceptionnel de 1 300 pages imprimé en caractères gothiques. Le premier est réalisé sur du parchemin en quatre volumes reliés, le second sur du papier en deux volumes, le papier étant moins épais que le parchemin. Haute de 40 centimètres, cette bible était destinée à être placée sur un lutrin. Elle visait donc la clientèle des abbayes, puisqu’à cette époque, dans les monastères bénédictins, les communautés mettaient l’accent sur la lecture de la Bible par un frère pendant les repas pris en commun au réfectoire. Le futur pape Pie II écrit dans sa correspondance en 1455 qu’il a vu à Francfort quelque chose d’extraordinaire : une bible « parfaitement lisible et exempte d’erreurs ». Les premières feuilles ont été imprimées en deux couleurs, le noir et le rouge, mais, assez rapidement, le rouge a été abandonné, probablement pour des raisons de coût car on pouvait ainsi passer la feuille sous la presse une seule fois au lieu de deux. Dans le même ordre d’idées, on est passé de 40 lignes dans les premiers feuillets à 42 lignes ensuite, ce qui permettait de diminuer assez considérablement le nombre de pages et de faire une économie de support. La question de la rentabilité est toujours prégnante pour une activité qui demande des fonds très importants, comme en témoigne un document précieux et unique : le contrat de fin d’association entre Gutenberg, son associé Peter Schöffer, spécialisé dans le domaine technique, et son financier, Johann Fust.

Hans Burgkmair, Saint Valentin, saint Étienne et saint Maximilien, dans Missale Pataviense, imprimé à Augsbourg par Erhard Ratdolt en 1494. Gravure sur bois en relief en couleurs. © BnF, Réserve des livres rares
Pouvez-vous détailler les différentes étapes de la reproduction sur une même page d’un texte et d’une image ?
C. V. : À l’origine, le modèle des typographes reste celui du manuscrit médiéval avec sa forme, sa mise en page et ses enluminures. D’où la volonté d’insérer des images dans le texte des livres imprimés. Les tout premiers d’entre eux sont ornés d’enluminures exactement comme les manuscrits. Venise, qui va s’affirmer comme l’un des premiers foyers européens du livre imprimé illustré, va rester presque jusqu’en 1490 fidèle à la tradition de l’image enluminée. Il faut dire qu’il y avait des enlumineurs de très haut niveau dans cette ville. Devant ces œuvres, certains visiteurs pourraient croire qu’il s’agit de manuscrits et non de livres imprimés, tant leur réalisation est exceptionnelle. Rapidement, cependant, plusieurs imprimeurs germaniques se confrontent au défi de gravures insérées dans le texte imprimé. Dès 1462, à Bamberg, en Bavière, Albrecht Pfister fait ce pari. Il recourt à des planches gravées sur bois puisque l’avantage de ce procédé est d’être en relief comme les caractères typographiques. L’ensemble peut donc passer sous la même presse. La gravure sur bois devient ainsi la technique privilégiée. Une autre technique est un peu à part parce qu’elle est sur cuivre mais en relief, la technique dite « du criblé » apparue pour les estampes en feuilles dans les années 1440 et qu’on retrouve employée dans une suite de la série de la Passion du Christ imprimée probablement vers 1460, accompagnée de texte typographique. Enfin, vers 1470 existent des tentatives d’insertion de gravures sur cuivre en taille douce, donc en creux. Le procédé reste marginal. La grande réalisation qui montre la possibilité de recourir à cette technique est un ouvrage réalisé à Florence entre 1481 et 1487 : une édition de la Divine Comédie. C’est un programme très ambitieux, puisqu’à l’origine 80 illustrations sont prévues. Finalement, seules 19 seront exécutées. L’artiste choisi est Baccio Baldini, un des plus grands graveurs de la Renaissance, qui aurait travaillé d’après des dessins de Botticelli. Dans les premiers chants, les gravures sont imprimées sur la même feuille que le texte et dans la suite, elles ont été collées postérieurement à l’impression. Deux explications sont possibles : soit le procédé technique était trop complexe, soit le graveur ne réalisait pas ses plaques assez vite étant donné les impératifs économiques de la sortie des ouvrages et on a dû dissocier l’impression du texte et celle des images. Nous ne disposons malheureusement pas d’archives pour le savoir.

Attribué à Baccio Baldini (1436-1487), d’après Sandro Botticelli (1445-1510), Dante et Virgile en présence des damnés brûlés par une pluie de feu, Florence, vers 1481-1487. Gravure sur cuivre en taille-douce. © BnF, Réserve des livres rares
La région rhénane a joué un rôle majeur dans cette révolution culturelle. Comment les innovations techniques se sont-elles ensuite répandues ailleurs en Europe ?
N. C. : À l’origine, tous les typographes connus sont germaniques, avec un mouvement de diffusion depuis le berceau de l’imprimerie. Puis, dans la seconde moitié du XVe siècle, d’autres typographes s’approprient peu à peu cette invention nouvelle qui va se répandre le long des routes marchandes de l’Europe, autour d’un axe qui relie Bruges à Venise. Les imprimés vont alors à la rencontre d’un marché de consommation. En plus des énormes bibles proposées aux monastères, les imprimeurs fabriquent également des calendriers sur des feuilles simples ou un petit livret contenant une grammaire latine – un des plus grands succès de librairie – à destination d’étudiants peu argentés. Après 1470, l’invention de Gutenberg se répand ailleurs en Europe par le biais des hommes d’Église ou de science, des marchands, d’abord en Italie. Dans le royaume de France, deux grands foyers d’impression se distinguent : Paris et Lyon. Mais, si dans la première ville, les imprimés sont essentiellement des œuvres religieuses et savantes destinées aux étudiants du Quartier latin, à Lyon il s’agit plutôt d’auteurs latins traduits ou d’ouvrages rédigés directement en français ou répondant à des besoins pratiques, et aussi de divertissement.

Albrecht Dürer (1471-1528), frontispice, Apocalipsis cum figuris (série de l’Apocalypse), imprimé à Nuremberg en 1511 (édition latine). © BnF, département des Estampes et de la Photographie
C. V. : Le succès de l’invention entraîne une grande circulation des images. Dès la fin du XVe siècle, les estampes de Martin Schongauer, né en Alsace, sont copiées dans les ateliers florentins. C’est une période où les artistes et les feuilles voyagent beaucoup.
« Avec l’invention de Gutenberg, les livres profanes se multiplient et les textes, y compris religieux, deviennent accessibles à un nombre de lecteurs beaucoup plus important. »
Les livres ne sont plus fabriqués dans les monastères. Quelles sont les conséquences sociales et techniques de la diffusion des nouveautés apportées par les imprimeurs ?
N. C. : Quand la nouvelle invention arrive sur le marché, elle suscite essentiellement l’admiration par sa précision, sa clarté et la facilité avec laquelle on peut imprimer de nombreux exemplaires. L’Église ne se rend pas compte immédiatement qu’elle va être dépossédée d’un pouvoir sur l’écrit, d’autant qu’avant même l’invention de l’imprimerie on avait commencé à rédiger des manuscrits parfois sans commanditaire, dans le but de les vendre à un public susceptible de les acheter. Il s’agissait d’ouvrages standardisés, quoique chers puisque la copie était très lente. Avec l’invention de Gutenberg, les livres profanes se multiplient et les textes, y compris religieux, deviennent accessibles à un nombre de lecteurs beaucoup plus important. Mais la question de la Réforme n’est qu’évoquée dans l’exposition car c’est un autre sujet à part entière.

Anonyme, Baudouin, comte de Flandre, imprimé par Antoine Neyret à Chambéry en 1485. © BnF, Réserve des livres rares
« Imprimer ! L’Europe de Gutenberg (1450-1520) », du 12 avril au 16 juillet 2023, Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand), quai François Mauriac, 75013 Paris. Tél. 01 53 79 59 59. bnf.fr.
Catalogue, 260 p., 49 €.