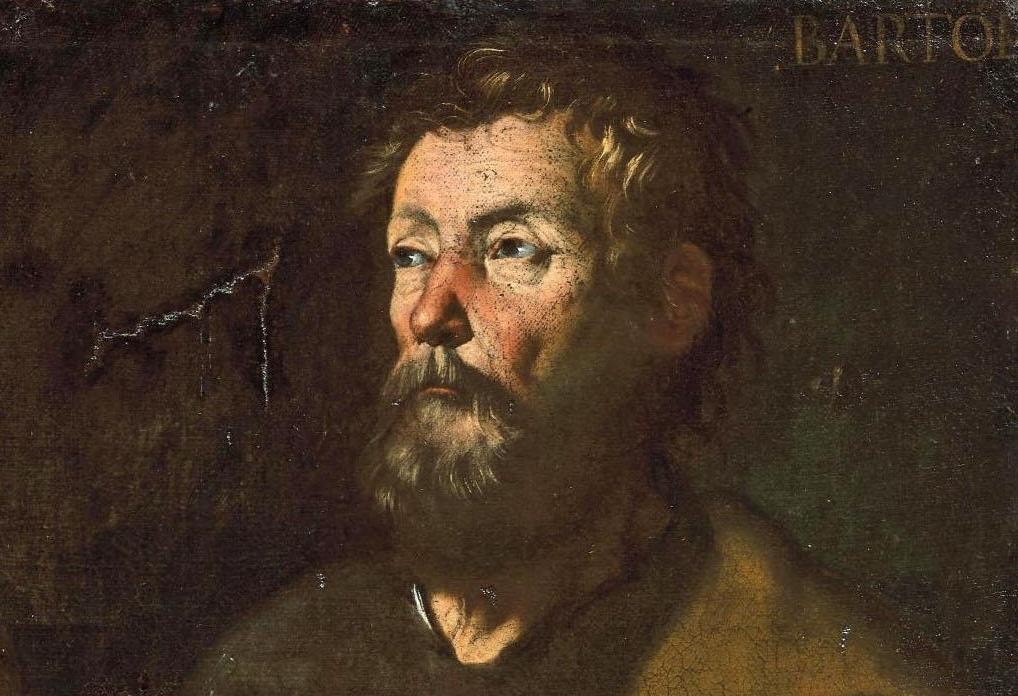Chronique du droit de l’art : « Affaire des faux meubles XVIIIᵉ du château de Versailles : un jugement trop favorable à l’État et des risques pour le marché »

Le château de Versailles. © Aterrom / stock.adobe.com
Près de dix ans après sa révélation, le scandale des faux meubles XVIIIe vendus au château de Versailles a encore des répercussions. Un récent jugement en témoigne : il annule la vente d’un fauteuil bergère inauthentique, préempté par l’État. Les juges rappellent à cette occasion les règles de prescription applicables à l’annulation de la vente et à la responsabilité des maisons de ventes. Mais en considérant l’erreur de l’État excusable, ils rendent une décision comportant des risques pour le marché…
L’objet de cet article n’est pas de décrire une saga connue qui défraie la chronique, mais plus modestement d’en analyser les conséquences juridiques pour le marché.
Lors d’une vente aux enchères du 9 juin 2011, le château de Versailles préempte, pour le compte de l’État français, une « Bergère à dossier plat à la reine en hêtre très finement sculpté et doré » d’« époque Louis XVI ». Celle-ci est décrite sans réserve au bordereau d’achat comme « livrée en 1789 » pour meubler le salon de compagnie d’Élisabeth de France au château, estampillée Jean-Baptiste-Claude Sené. Elle est acquise pour 247 840 € (prix marteau de 200 000 €, et 47 840 € de frais).

La bergère à dossier plat à la reine en hêtre très finement sculpté et doré d’« époque Louis XVI » préemptée par le château de Versailles le 9 juin 2011. © DR
Les procédures pénale et civile
En 2016, l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) ouvre une enquête pénale, portant sur une filière de recel et de fabrication de faux meubles du XVIIIe siècle. L’État français est informé des doutes sur l’authenticité de la bergère et se constitue partie civile dans la procédure pénale.
Parallèlement, en 2017, le château de Versailles et l’État saisissent les juridictions civiles afin d’obtenir l’annulation de la vente. Ils assignent le vendeur, la maison de ventes et l’expert de la vente. En 2019, l’expertise judiciaire menée au pénal confirme que la bergère n’est pas authentique. Pire, il résulte du jugement que « l’inauthenticité de la bergère […] n’est pas discutée par les parties […], le vendeur ne contestant pas d’ailleurs l’avoir lui-même fabriquée ».
Les arguments de Versailles et des défendeurs
Au civil, le château et l’État soutiennent que leur consentement a été vicié par une erreur sur les qualités du meuble ; et subsidiairement, qu’ils ont été trompés par un dol. Ils demandent la nullité de la vente : le meuble doit être restitué, en contrepartie du remboursement de son prix et des frais.
En réponse, les défendeurs avancent deux arguments principaux. Premièrement, la prescription. Deuxièmement, le vendeur fait valoir que les vices du consentement dont se prévalent les acheteurs ne sont pas caractérisés.
Le jugement
Le Tribunal judiciaire de Paris prononce la nullité de la vente. À cette fin, il distingue avec rigueur la prescription applicable à l’annulation de la vente, de celle à laquelle la responsabilité de la maison de ventes est soumise (I). Toutefois, il fait preuve d’une étonnante souplesse en jugeant excusable l’erreur du château et de l’État (II).
I. La distinction de la prescription de l’action en annulation de la vente, de celle de l’action en responsabilité de la maison de ventes
Lors d’une action en annulation de vente aux enchères, deux prescriptions doivent être distinguées.
D’une part, l’action en annulation de la vente pour erreur ou dol, entre l’acheteur et le vendeur, est soumise à la prescription de droit commun et est enfermée dans un double délai : elle peut être demandée durant cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits fondant son action (délai « glissant » de l’article 2224 du Code civil), dans la limite de vingt ans à compter de la vente (délai « butoir » de l’article 2232 du Code civil).
La question de l’expiration du délai
Afin d’échapper à l’annulation de la vente, le vendeur argue en l’occurrence que le délai pour agir en nullité est expiré et que l’action à son encontre est donc irrecevable. Mais le tribunal constate que le doute sur l’authenticité de la bergère litigieuse est apparu le 7 juin 2016, lors de l’interpellation du vendeur et alors que le château et l’État ont été informés de l’ouverture d’une procédure pénale. L’assignation date de 2017, soit moins de cinq ans après la découverte de ce doute. L’action en annulation de la vente est donc recevable contre le vendeur.
D’autre part, l’action en responsabilité civile engagée à l’occasion des ventes aux enchères publiques, contre l’opérateur de ventes et son expert, est soumise à une prescription courte et dérogatoire au droit commun : le délai est de cinq ans à compter de l’adjudication (Art. L.321-17 du Code de commerce). Il est évidemment très favorable. La maison de ventes soutient donc que sa responsabilité ne peut plus être engagée. Elle est suivie sur ce point par le tribunal.
Le remboursement des frais
Mais cette prescription ne porte pas sur les frais. Le tribunal statue que l’annulation de la vente rend les frais de vente indus. La prescription de droit commun s’applique à cette demande. Ils doivent donc être remboursés. C’est classique, mais ce rappel est utile.
Si la prescription de la responsabilité de la maison de ventes est bien acquise (la vente a eu lieu en 2011 et l’action a été introduite en 2017, soit plus de cinq ans après), elle est sans incidence. Le tribunal relève que seule la nullité de la vente est demandée, et applique une solution constante : « L’article L.321-17 du code de commerce, propre aux ventes volontaires, déroge au texte général de la prescription de l’article 2224 du code civil spécifiquement en matière d’action en responsabilité civile. Il n’a en revanche pas à s’appliquer dans le cadre d’une demande d’annulation d’un contrat ». Les règles de la prescription de l’action en nullité s’appliquent. Le délai de prescription court donc à compter de la découverte de l’erreur ou du dol, tant contre le vendeur que contre la maison de ventes.
« Le château et l’État invoquent leur erreur, car ils ont acquis la bergère avec la conviction qu’elle était authentique, d’époque XVIIIe, et que sa provenance était prestigieuse. »
II. L’erreur de l’État est-elle vraiment inexcusable ?
De par la loi, l’erreur ne constitue une cause de nullité de la vente que si elle est excusable (article 1132 du Code civil). Elle n’est donc pas sanctionnée lorsqu’elle résulte d’une imprudence, d’un manque de diligence, voire de la négligence ou d’une faute de celui qui l’invoque. Le caractère excusable de l’erreur s’apprécie en fonction des aptitudes et insuffisances du demandeur. L’erreur d’un professionnel ou d’un spécialiste agissant dans son domaine de compétence est ainsi appréciée plus sévèrement que celle d’un profane. Ainsi, par exemple, commet une erreur inexcusable ne pouvant entraîner la nullité de la vente un spécialiste de l’art russe qui achète une toile d’un artiste russe, dans une vente cataloguée, avec une notice rédigée par un expert en peinture (Cass. Civ. 1re, 9 avril 2015, RG n°13-24.772).
À l’inverse, l’erreur provoquée par le dol, c’est-à-dire par une manœuvre frauduleuse destinée à tromper, est toujours excusable (article 1139 du Code civil). Les circonstances dans lesquelles le dol intervient, ou les connaissances de la victime, sont indifférentes.
L’erreur de l’État
Le château et l’État invoquent leur erreur, car ils ont acquis la bergère avec la conviction qu’elle était authentique, d’époque XVIIIe, et que sa provenance était prestigieuse. Ils ne l’auraient pas préemptée s’ils avaient su que ces qualités n’existaient pas. Subsidiairement, ils arguent avoir subi un dol, c’est-à-dire avoir été trompés par les manœuvres du vendeur et le descriptif de la bergère.
Non sans aplomb, le vendeur répond que l’erreur du château et de l’État est inexcusable, car l’expertise judiciaire révèle que la mauvaise qualité de l’objet était « visible à l’œil nu » ; et que les professionnels et experts dont les acquéreurs s’étaient entourés auraient dû constater son inauthenticité. Il fait aussi valoir qu’il n’a pas participé à la vente, ni donné d’indication à la maison de ventes, et n’a donc commis aucune manœuvre dolosive.
La réponse du tribunal
Le tribunal répond à cet argumentaire de manière lapidaire : « en dépit de la qualité des demandeurs, le caractère inexcusable de l’erreur ne saurait être retenu dès lors qu’ils ont agi en qualité d’acheteur à l’occasion d’une vente aux enchères dans le cadre de laquelle l’authenticité de la bergère était attestée par un expert et n’était démentie par aucun élément au moment de la vente ». Par conséquent, le tribunal considère que l’erreur est caractérisée et annule la vente. Le château et l’État doivent restituer la bergère. En contrepartie, le vendeur est condamné à restituer le prix ; et la maison de ventes à restituer les frais de vente.
Les conséquences de cette décision
Cette décision protège les intérêts de l’État. Mais elle n’est pas sans conséquence générale pour le marché. Concrètement, elle revient à considérer que l’erreur d’un acquéreur serait excusable dès lors qu’un expert est intervenu à la vente et a validé l’authenticité du bien litigieux. Ce serait donc toujours le cas de l’erreur commise lors d’une vente aux enchères avec expert. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de prendre en compte la compétence de l’acheteur professionnel, spécialiste ou sachant.
À tout le moins, il faudrait alors atteindre un degré de compétence très élevé puisque cette expertise ne pourrait plus être opposée à l’État, au ministère de la Culture, à l’un des plus prestigieux musées du monde, à leur bataillon de conservateurs, avec des moyens sans équivalent. Le risque est que la jurisprudence évince ainsi une disposition légale, exigeant une erreur excusable (article 1132 du Code civil), de façon quelque peu automatique.
Une manière possible d’éviter cet écueil
Pourtant, il y avait en l’occurrence un moyen d’éviter cet écueil, tout en protégeant les intérêts de l’État. Le fondement du dol apparaissait en effet tout indiqué pour prononcer la nullité. Le vendeur ne contestait pas avoir fabriqué la bergère de toute pièce. Il s’était abstenu d’en informer la maison de ventes et les acquéreurs. Ses manœuvres et son silence auraient permis de caractériser le dol, rendant ainsi l’erreur du château et de l’État excusable.
Nous ignorons si la procédure fait l’objet d’un appel. Il faudrait alors espérer une motivation moins lapidaire et cette fois fondée sur le dol. À défaut, ce jugement pourrait constituer un dangereux précédent : les demandeurs à l’annulation d’une vente auront beau jeu de l’invoquer pour écarter le caractère inexcusable de leur erreur, dès lors qu’un expert est intervenu à la vente… Le volet pénal doit être jugé dans quelques semaines. Il apportera probablement des éclaircissements utiles sur le comportement du vendeur.



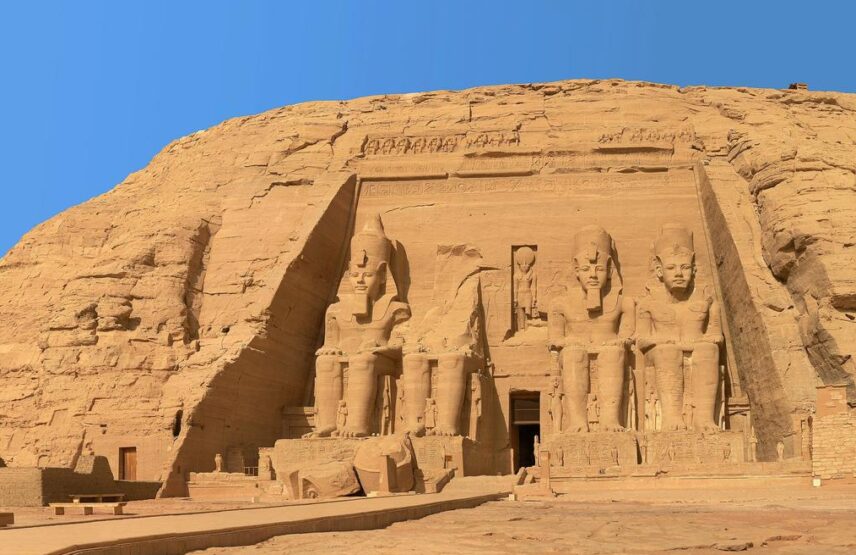
![Alberto Giacometti (1901-1966), Femme [plate V], vers 1929. Bronze, 55,5 x 33,6 x 7,7 cm. Paris, collection Fondation Giacometti.](https://actu-culture.com/wp-content/uploads/2026/01/preview__alberto-giacometti-femme-plate-v-1929-paris-collection-fondation-giacometti.jpg)